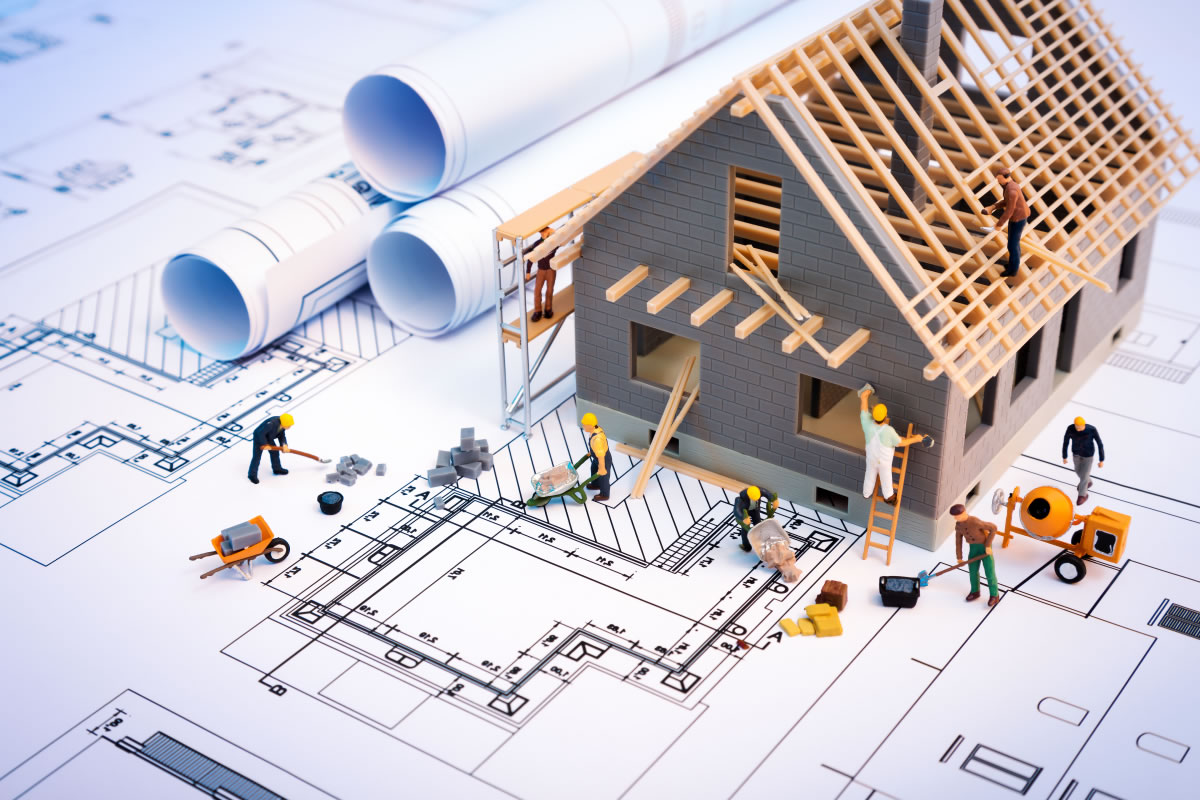Alors que la France a enregistré en 2023 sa plus faible mortalité depuis des années, ce tournant statistique ne doit pas masquer une réalité économique et sanitaire bien plus complexe. Si la chute des décès liés au Covid-19 explique une large part de cette amélioration, les grandes causes de mortalité persistent, et avec elles, des coûts humains et financiers considérables. Entre déséquilibres régionaux et poids croissant des pathologies chroniques, les données officielles révèlent une France en pleine mutation démographique… mais pas sans conséquences.
Moins de morts, mais un système toujours sous tension
Avec 637 082 décès recensés en 2023, soit 36 000 de moins qu’en 2022, la France atteint un niveau historiquement bas. Ce recul fait écho à une dynamique observée dans la plupart des pays européens, et s’accompagne d’un taux de mortalité standardisé de 828,3 pour 100 000 habitants, en dessous même de 2019, dernière année « pré-Covid ».
Cette baisse s’explique principalement par la réduction massive des décès liés au SARS-CoV-2, selon les études croisées de la DREES, du CépiDc-Inserm et de Santé Publique France. Ces organismes estiment que plus de 60 % de la baisse est directement imputable au recul de l’épidémie.
Mais au-delà de cette embellie, la mortalité globale reste plus élevée que ce qu’aurait prédit la tendance 2015–2019, signe que l’impact structurel de la pandémie reste profond. Par ailleurs, le vieillissement de la population pèse de plus en plus lourd sur les dépenses de santé publique et les budgets de protection sociale, notamment dans les secteurs liés à la dépendance.
Pour Éric Bréchet, économiste de la santé:
Il ne faut pas confondre un accident statistique positif avec une inversion de tendance. Le système reste sous pression, notamment sur les dépenses liées aux maladies chronique.
Cancer, AVC, pathologies chroniques : le vrai coût de la mortalité
Si le Covid-19 a reculé, les tumeurs demeurent en tête des causes de décès, représentant 27 % de la mortalité en France, soit 239 morts pour 100 000 habitants. Ces maladies touchent souvent une population plus jeune, générant un impact économique plus large en termes de perte d’années de vie et de productivité.
Le coût direct des traitements oncologiques, combiné à l’allongement des protocoles thérapeutiques, pèse lourd sur les budgets hospitaliers. De plus, certains cancers — notamment du pancréas ou des bronches chez les femmes — continuent d’augmenter.
En seconde position, les maladies cardio-neurovasculaires (AVC, infarctus, insuffisance cardiaque) restent stables, mais leur fréquence croît avec le vieillissement, amplifiant les besoins en soins post-aigus, rééducation et maintien à domicile. Leur poids budgétaire est considérable, en particulier dans les territoires ruraux et vieillissants.
Les maladies respiratoires et infectieuses, quant à elles, repartent légèrement à la hausse, à rebours de la dynamique générale. La Covid-19 figure toujours dans le top 10 des causes de décès, soulignant son ancrage durable dans le paysage sanitaire, malgré la fin de l’urgence pandémique.
⚠️ Enfin, les maladies neurologiques, endocriniennes, digestives et génito-urinaires, bien que moins visibles, affichent des niveaux toujours supérieurs à ceux projetés avant la pandémie. Ces pathologies sont chroniques, complexes, et très coûteuses, avec une progression silencieuse mais budgétairement explosive.
️ L’œil de l’expert : défis sanitaires
La baisse de la mortalité en 2023 ne signe pas la fin des défis sanitaires, bien au contraire. Le vieillissement accéléré de la population, l’explosion des maladies chroniques et les déséquilibres régionaux alimentent un risque financier croissant pour les systèmes de santé et de protection sociale.
Cette « bonne nouvelle » statistique doit donc être analysée avec prudence. Si les décès reculent, les dépenses de long terme, elles, progressent sans relâche. Et dans une économie où la santé publique représente une part croissante du PIB, ces tendances façonnent l’avenir budgétaire du pays.