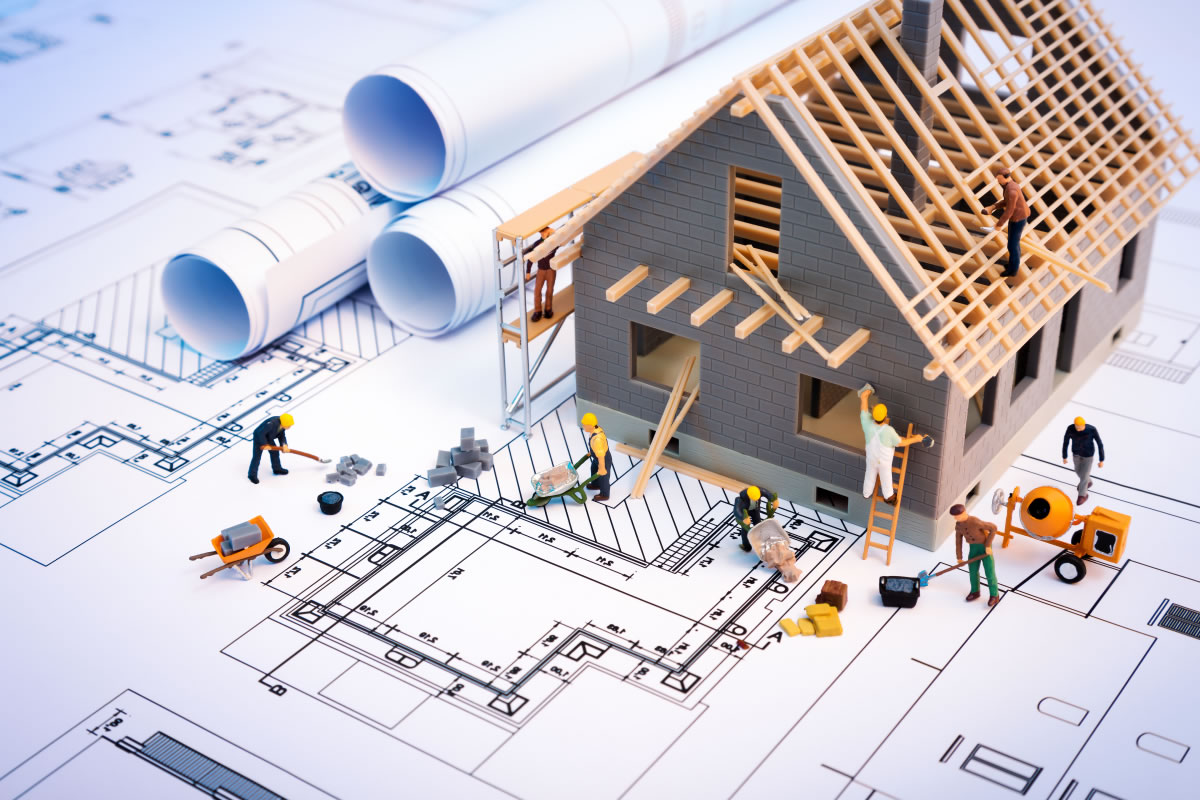Travailler plus pour dépenser moins ? Le gouvernement frappe fort. Dans un contexte budgétaire sous tension et après l’annonce présidentielle d’un « effort de guerre » de 6,5 milliards d’euros pour les années 2026 et 2027, François Bayrou, Premier ministre, a dévoilé mardi 15 juillet un projet qui fait déjà grincer des dents : la suppression de deux jours fériés – le lundi de Pâques et le 8 mai. Objectif affiché : accroître l’activité économique et réduire de 43,8 milliards d’euros le déficit public d’ici fin 2026. Derrière cette mesure symbolique et polémique, c’est toute une logique économique de « redressement par le travail » qui se dessine. Décryptage.
Produire plus pour combler le trou budgétaire
François Bayrou l’a martelé :
Il faut que toute la Nation travaille plus.
Dans son allocution, il défend l’idée que supprimer deux jours de repos national pourrait générer 4,2 milliards d’euros d’économie supplémentaires grâce à l’augmentation du volume de travail annuel. Un levier d’action présenté comme prioritaire dans le cadre du plan d’ajustement budgétaire 2026.
Ces journées, transformées en journées de solidarité à l’image du lundi de Pentecôte, permettraient aux employeurs de reverser des contributions ciblées à l’État sans augmentation de la masse salariale. Le dispositif, déjà rodé, pourrait être étendu avec un impact jugé « mécanique et favorable à la croissance » selon Sylvain Bersinger, chef économiste du cabinet Asterès. Ce dernier souligne que cette mesure « ramène plus d’argent dans les caisses publiques et participe au rééquilibrage du budget ».
Derrière la technicité du raisonnement, le gouvernement cherche donc à faire d’un symbole – le jour férié – un outil budgétaire et macroéconomique. En pleine crise de confiance dans les institutions, il s’agit aussi de convaincre les marchés que l’exécutif reste maître de la trajectoire budgétaire.
Un coût politique potentiellement explosif
Mais cette stratégie de rigueur ne passe pas inaperçue.
Une insulte sociale à près de 30 millions de salariés
dénonce le député Alexis Corbière (Seine-Saint-Denis), soulignant le caractère inégalitaire de la mesure. Les critiques pointent du doigt une réforme qui pèserait une fois de plus sur les travailleurs, sans toucher les grands bénéficiaires des politiques fiscales récentes.
Jordan Bardella, président du Rassemblement National, fustige:
une attaque contre notre histoire, contre nos racines
faisant référence à la portée symbolique du 8 mai. De son côté, la CGT, par la voix de Thomas Vacheron, juge la réforme « catastrophique » pour la majorité des Français, regrettant que le gouvernement préfère « rogner sur les droits sociaux plutôt que remettre en cause les 200 milliards d’aides aux entreprises ou les niches fiscales des plus riches ».
Dans un contexte où le pouvoir d’achat reste une préoccupation majeure pour les ménages, supprimer deux jours de répit national pourrait cristalliser un mécontentement profond, et remettre en cause la légitimité sociale des arbitrages budgétaires.
L’œil de l’expert : toucher aux symboles
D’un strict point de vue économique, cette réforme pourrait effectivement générer une hausse marginale de la productivité nationale et apporter un bol d’air aux finances publiques. Mais sa portée symbolique, combinée à son effet socialement régressif, risque d’éroder encore davantage la confiance des citoyens envers leurs institutions. Une économie de 4,2 milliards d’euros obtenue au prix d’un coût politique et social élevé est-elle vraiment durable ? Dans un pays marqué par des tensions sociales récurrentes, la suppression de jours fériés, aussi rationnelle soit-elle économiquement, s’avère une stratégie hautement inflammable.