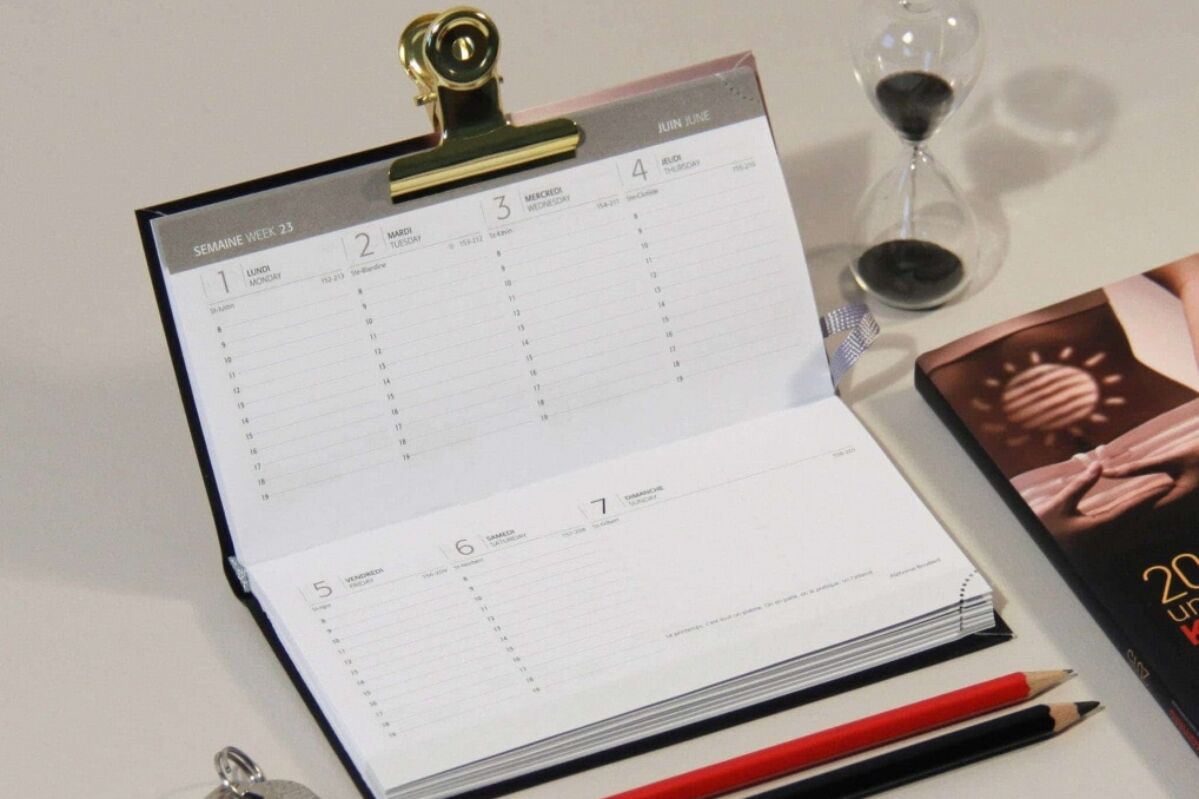Le ministère de l’Éducation nationale a récemment officialisé le calendrier scolaire pour l’année 2025-2026. Derrière ce simple découpage des congés par zones A, B et C, se joue en réalité un équilibre complexe entre organisation familiale, stratégie touristique et retombées économiques majeures. Les dates de vacances et jours fériés, loin d’être anodines, impactent directement des secteurs entiers de l’économie française – du tourisme aux transports en passant par la consommation des ménages.
🎿 Vacances scolaires : un levier économique
Le calendrier répartit les congés entre trois zones :
Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers.
Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Normandie, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Strasbourg, Corse.
Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles.
Les vacances communes (Toussaint du 18 octobre au 2 novembre, Noël du 20 décembre au 4 janvier) créent des pics de consommation généralisés.
Mais ce sont surtout les vacances d’hiver et de printemps, échelonnées par zone, qui constituent un très fort levier économique. Selon le ministère, ce décalage permet une meilleure « gestion de l’afflux touristique », un enjeu crucial pour les stations de ski comme pour l’hôtellerie de loisir :
- la zone A ouvrira le bal en février (7 au 22)
- suivie de la zone B (14 février au 1er mars)
- puis la zone C (21 février au 8 mars).
Même logique au printemps, avec une répartition d’avril à mai.
L’industrie du tourisme d’hiver, qui pèse près de 10 milliards d’euros par saison en France, est directement dépendante de cette organisation. Sans cet échelonnement, les infrastructures hôtelières, les transports ferroviaires et aériens ou encore la restauration locale subiraient une saturation ingérable, et manque à gagner par voie de conséquence.
📆 Jours fériés : l’ombre d’une réforme
Outre les vacances, les jours fériés structurent fortement l’année scolaire et… l’économie. Le calendrier 2025-2026 en compte plusieurs majeurs : l’Armistice (11 novembre), Pâques (6 avril), Fête du Travail (1er mai), Victoire de 1945 (8 mai), Ascension (14 mai) et Pentecôte (25 mai).
Ces journées, souvent prolongées par des ponts, sont un moteur de consommation (voyages, loisirs, restauration), mais elles représentent aussi une perte de productivité évaluée à 2 à 4 milliards d’euros par jour férié chômé selon divers économistes.
C’est dans ce contexte que le Premier ministre François Bayrou a évoqué une piste de réforme : la possible suppression du lundi de Pâques et du 8 mai comme jours fériés. Une mesure qui viserait à réaliser des économies de compétitivité, mais qui suscite un débat houleux.
Les syndicats y voient une remise en cause du modèle social français, tandis que les acteurs du tourisme redoutent une contraction de la consommation domestique.
Ce type d’ajustement pourrait affecter directement le chiffre d’affaires des secteurs hôteliers et de loisirs, qui reposent largement sur ces périodes de mini-vacances
analyse un économiste du secteur interrogé par Les Échos.
👁️ L’œil de l’expert : trouver les équilibres
Au-delà d’un simple planning scolaire, le calendrier 2025-2026 illustre la façon dont l’État orchestre l’équilibre entre temps éducatif, attractivité touristique et dynamisme économique. Chaque semaine de congés décalés ou chaque jour férié supprimé pèse sur des milliards d’euros de retombées.
La décision de maintenir ou non certains jours fériés pourrait devenir un enjeu politique de premier plan, révélant le dilemme permanent entre compétitivité économique et qualité de vie sociale. Dans un contexte de croissance fragile et de budgets publics contraints, les arbitrages du gouvernement sur ce sujet seront scrutés de près.