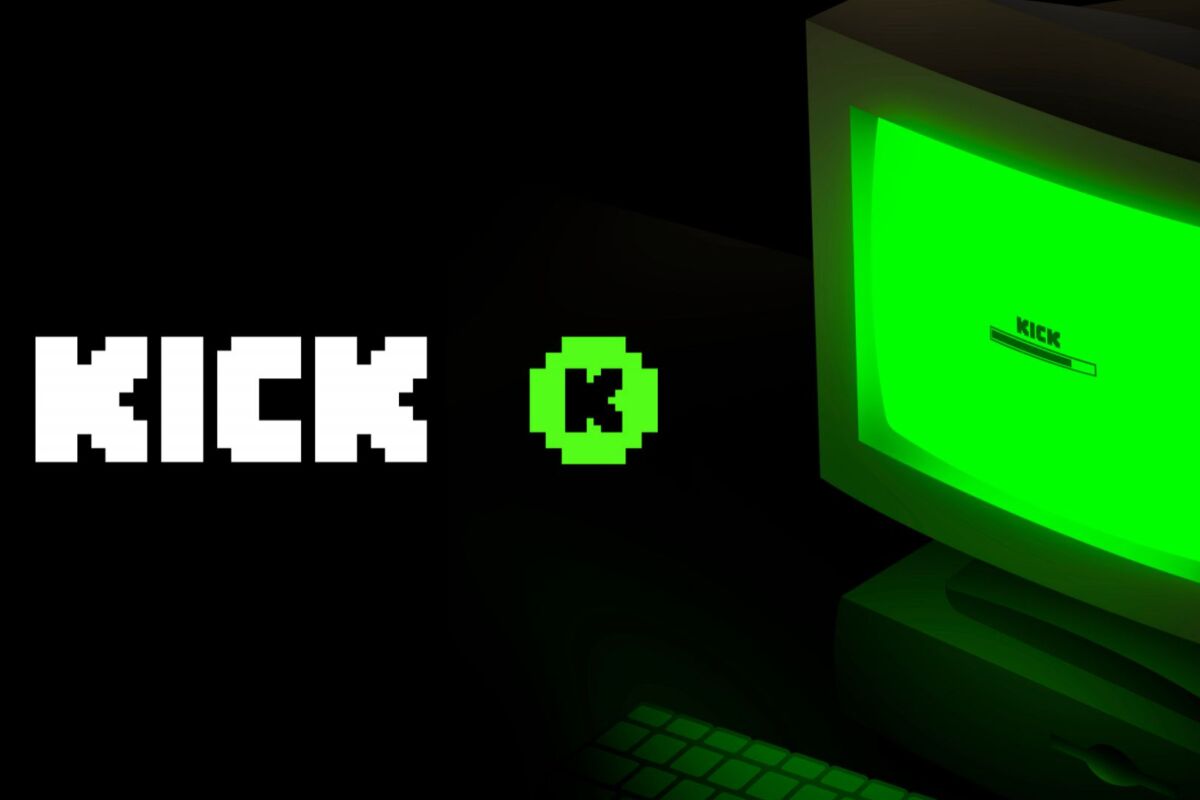L’affaire Jean Pormanove, mort en direct sur la plateforme Kick, fait grand bruit en ce mois d’août, et met surtout en lumière un bouleversement inquiétant : le streaming n’est plus seulement un loisir, mais un marché mondial de l’attention où l’argent circule à une vitesse fulgurante et où la morale recule face aux logiques financières. En quelques années, Kick s’est imposée comme une alternative « rentable » à Twitch ou YouTube, séduisant des stars grâce à des contrats colossaux. Mais derrière cette prospérité, ce sont les dérives d’un capitalisme numérique débridé qui éclatent au grand jour.
💸 Liberté totale & profits record
Créée en 2022 par Ed Craven et Bijan Tehrani, fondateurs du mastodonte du casino en ligne Stake, Kick s’est rapidement hissée au rang de “nouveau paradis” du streaming. Son atout ? Une politique de revenus imbattable. Là où Twitch conserve 50 % des recettes générées par ses créateurs, Kick ne prélève que 5 %.
Résultat : des transferts spectaculaires. Des figures comme xQc (100 M$ de contrat selon la presse), Amouranth, Hikaru Nakamura ou Adin Ross ont quitté Twitch pour rejoindre la plateforme verte, séduites par la promesse de gains sans précédent et d’une liberté quasi absolue.
Mais cette stratégie n’est pas sans arrière-pensée. Kick s’est imposée entre autre comme un canal de diffusion pour les flux financiers liés aux jeux d’argent en ligne, secteur frappé de restrictions ailleurs. L’essor de Kick illustre une hybridation entre économie de l’attention et logique spéculative : chaque interaction, chaque don, chaque clic devient monétisable.
Ici, vous êtes libres, et mieux payés
tel est le message implicite de Kick. Mais cette liberté a un prix : un quasi-vide de modération. Là où Twitch bannit, Kick accueille. Les propos haineux, les contenus sexualisés ou encore les jeux d’argent interdits ailleurs trouvent refuge sur cette plateforme. En d’autres termes, Kick capitalise sur ce que les autres refusent.
⚖️ Et la souffrance devient un marché
La tragédie de Jean Pormanove révèle les effets pervers de ce modèle. Harcelé et humilié par des streamers influents comme « Naruto » et « Safine », il est devenu malgré lui une “marchandise humaine” du live, chaque humiliation générant des dons, des surenchères et des rires. L’homme vulnérable a été alors transformé en produit d’appel économique, telle une tête de gondole de supermarché, dans un système où plus la transgression choque, plus elle rapporte.
Ce phénomène ne se limite pas à Kick. TikTok, Twitch et YouTube ont également vu émerger une économie de l’humiliation : tirs de billes contre paiement, gages humiliants, mises en danger orchestrées par les spectateurs eux-mêmes via des donations. Chaque live devient une arène, où la violence et le malaise sont convertis en revenus.
La question centrale n’est donc pas uniquement éthique, mais aussi économique et systémique. Le modèle de Kick repose sur une équation simple :
Plus de liberté = moins de contrôle
Moins de contrôle = plus de contenus extrêmes
Contenus extrêmes = plus d’audience et donc plus de flux financiers
Ce mécanisme révèle une économie de l’attention devenue cannibale, où l’individu est réduit à une fonction marchande. Comme l’écrivait déjà Yves Boisset dans Le prix du danger (1983), ou plus récemment la série Squid Game, l’industrie du spectacle pousse jusqu’à l’absurde et la marchandisation de la souffrance.
👁️ L’œil de l’expert : retour à l’arène
Derrière l’affaire Pormanove se cache un défi économique et sociétal majeur : comment réguler une industrie où la valeur ne réside plus dans le contenu mais dans le choc émotionnel qu’il procure ? Kick prospère car elle répond à une demande — celle d’un public avide de sensations fortes et d’une monétisation rapide. Mais à long terme, ce modèle est insoutenable : il expose la plateforme à des risques d’image, à des sanctions légales et à une défiance croissante des annonceurs.
Si rien n’est donc fait, le streaming pourrait devenir le miroir noir de notre époque : un espace où la finance l’emporte sur l’éthique, et où l’humain devient la variable d’ajustement. La question n’est plus seulement technologique. Elle est civilisationnelle.