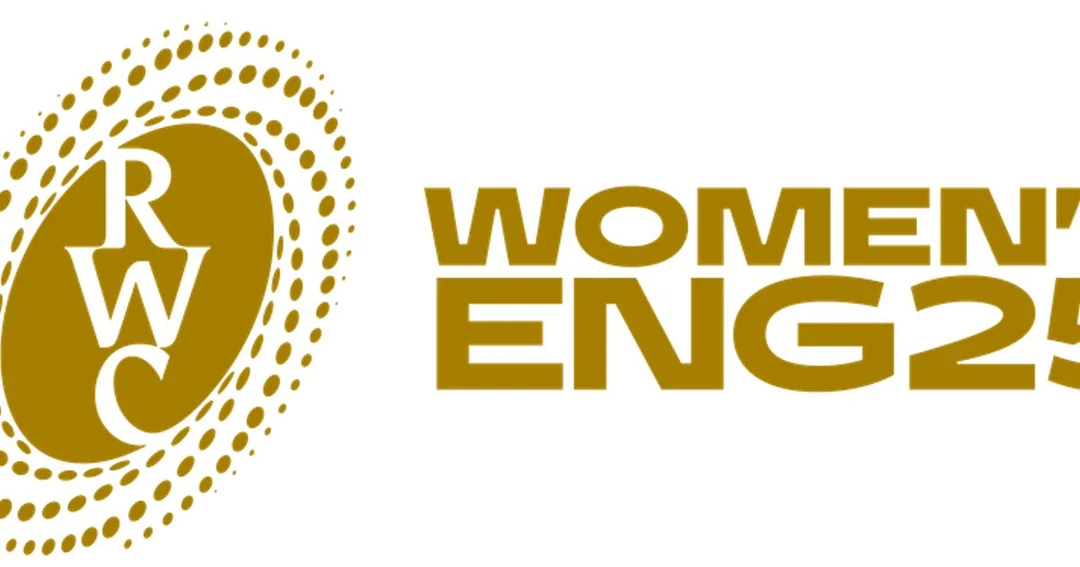Alors que la 10ᵉ Coupe du monde féminine de rugby s’ouvre ce 22 août au Royaume-Uni avec une première historique – 16 nations engagées contre 12 auparavant –, l’événement met déjà en lumière de profondes fractures économiques. Derrière la vitrine sportive, les conditions financières des joueuses témoignent d’un monde à deux vitesses, où certaines athlètes bénéficient d’un cadre professionnel complet tandis que d’autres doivent… ouvrir des cagnottes en ligne pour pouvoir jouer.
🕳 Un gouffre économique entre nations
Selon une enquête du Guardian, certaines équipes arrivent à la compétition avec un lourd handicap… financier. Exemple marquant : chez les Samoanes, la moitié des joueuses (16 sur 32) a dû recourir à des cagnottes pour financer leurs charges personnelles (crédit immobilier, garde d’enfants, dépenses courantes) faute de contrat professionnel. Certes, World Rugby prend en charge les frais de déplacement et d’hébergement, mais cela reste loin de couvrir les besoins réels des joueuses.
À l’opposé, certaines sélections bénéficient de contrats solides, révélant une fracture presque choquante. En Angleterre, les Red Roses perçoivent des contrats allant de 17 000 à plus de 50 000 € annuels, avec en prime 1 500 £ par match joué (soit environ 1 700 €). Les Néo-Zélandaises, elles, évoluent dans un système professionnel abouti : salaires à temps plein (25 000 à 35 000 € par an), primes hebdomadaires autour de 1 000 € en tournoi et couverture sociale renforcée.
Pour d’autres pays comme le Canada, l’Australie ou les États-Unis, des contrats existent mais restent inégaux, ce qui fragilise la stabilité financière des athlètes. Plus bas dans la hiérarchie, le Japon et les Samoa n’offrent qu’une simple indemnité journalière, sans sécurité contractuelle.
🏈 Un contraste qui interroge
La situation des nations intermédiaires souligne aussi un paradoxe inquiétant. En France, la majorité des joueuses est sous contrat avec la Fédération, mais beaucoup doivent cumuler avec un emploi ou des études pour vivre correctement. En Espagne, certaines bénéficient de bourses, mais rien de comparable avec le confort des grandes nations du rugby féminin.
Comme le résume un article du Guardian, cette Coupe du monde repose sur une équité sportive en trompe-l’œil : si le ballon est le même pour toutes, les conditions économiques diffèrent radicalement. Les équipes professionnelles (Angleterre, Nouvelle-Zélande) disposent de structures d’entraînement et d’un suivi médical dignes du haut niveau, là où d’autres sélections doivent bricoler.
Ce déséquilibre financier ne pèse pas seulement sur la qualité du jeu : il menace la crédibilité du tournoi. Car comment imaginer une compétition équitable quand certaines équipes affrontent l’élite mondiale tout en jonglant avec des emplois alimentaires ou des dettes personnelles ?
👁️ L’œil de l’expert : créer un socle commun
Derrière l’enthousiasme que suscite cette Coupe du monde féminine de rugby, se dessine une faille structurelle majeure : l’absence d’un modèle économique unifié. Tant que certaines joueuses seront contraintes de recourir à des cagnottes pour représenter leur pays, l’ambition d’une véritable professionnalisation restera un mirage.
Pour World Rugby, l’enjeu est clair : investir dans l’égalité salariale et créer un fonds international capable de garantir un socle minimum de rémunération. Faute de quoi, l’écart entre nations riches et émergentes ne fera que s’élargir, au risque de transformer la compétition en vitrine déséquilibrée.