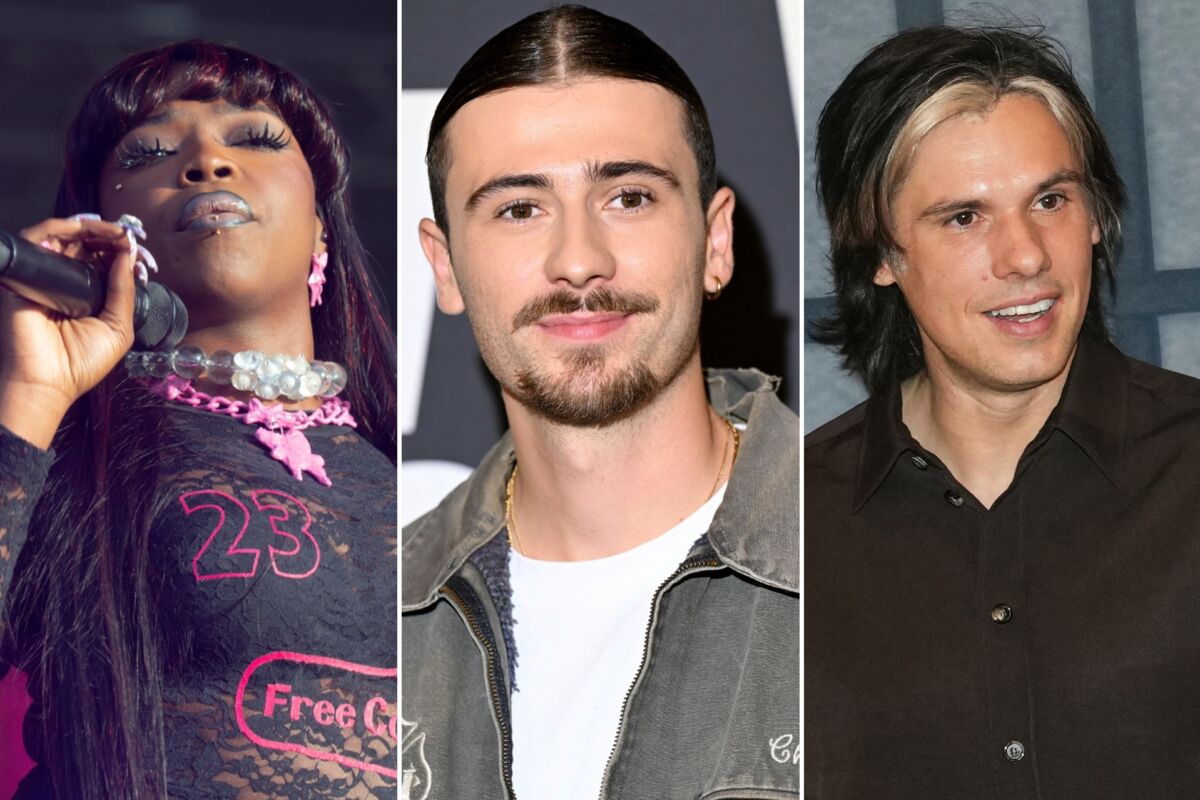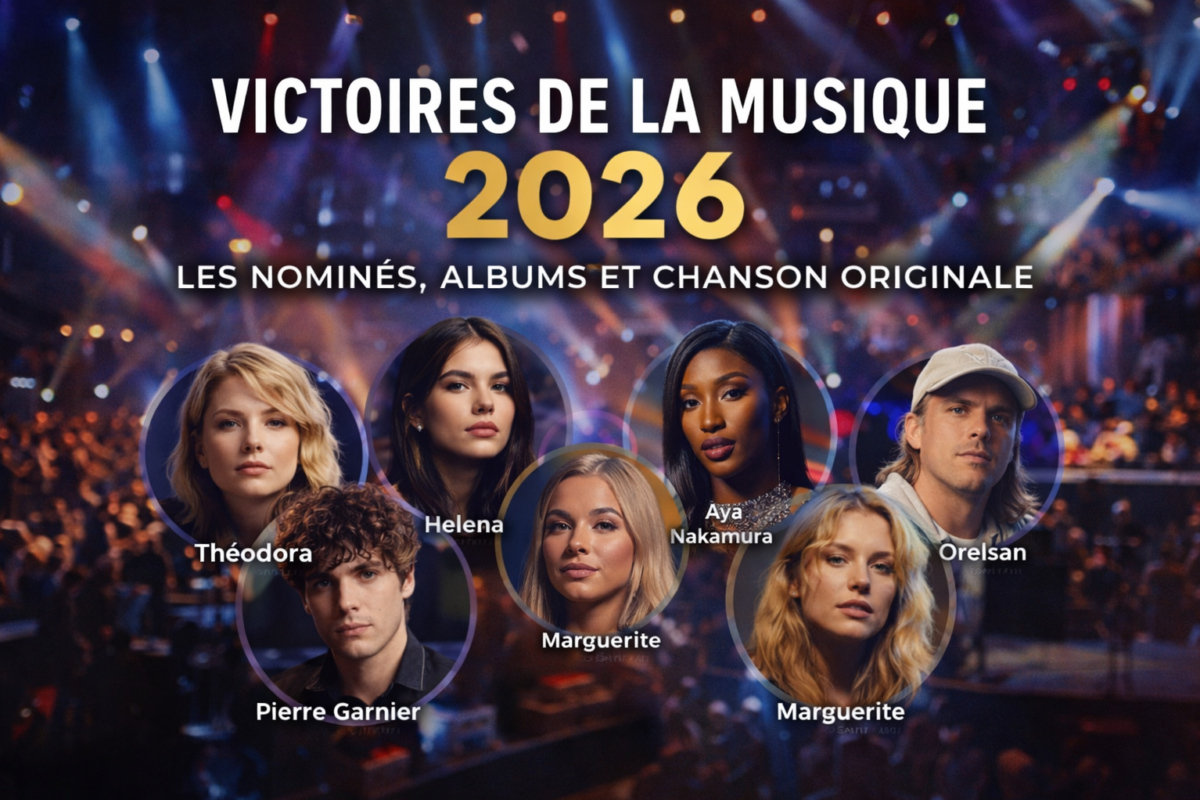La France affiche un taux de pauvreté inférieur à la moyenne européenne, mais cache une réalité plus contrastée : elle compte plus de personnes modestes que ses voisins. Selon une étude récente de la Drees publiée le 24 septembre 2025, cette dualité révèle des enjeux économiques et sociaux majeurs, notamment dans un contexte d’inflation et de recul du pouvoir d’achat.
📊 Un équilibre relatif mais fragile
Selon la Drees, les personnes considérées comme pauvres disposent d’un niveau de vie inférieur à 60 % de la médiane nationale, tandis que les personnes modestes se situent entre 60 et 75 % de ce seuil. En 2022, la France comptait 14 % de pauvres contre 17 % en moyenne dans l’UE, mais 13 % de personnes modestes, légèrement au-dessus de la moyenne européenne de 12 %.
La France se situe à mi-chemin entre le Luxembourg (18 % de pauvres) et la Finlande (11 %)
observe la Drees. Si le taux de pauvreté reste inférieur à la moyenne, certaines populations restent particulièrement exposées : familles monoparentales, immigrés hors UE, chômeurs et personnes seules. En France, 39 % des familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté, contre un tiers en moyenne dans l’UE, tandis que 42 % des immigrés extra-UE se trouvent dans des situations précaires.
Le contraste se voit également chez les retraités : 10 % sont pauvres en France, contre 15 % dans l’UE, plaçant le pays parmi les plus performants d’Europe dans ce domaine. Cependant, ce tableau rassurant masque la montée récente de la pauvreté. Selon l’Insee, le taux a atteint 15,4 % en 2023, le niveau le plus élevé depuis 1996, soit 9,8 millions de personnes, conséquence directe de l’inflation et du recul du niveau de vie des ménages modestes.
⚠️ Un signal d’alerte
La proportion croissante de personnes modestes représente un défi économique important. Ces ménages ont des revenus insuffisants pour investir ou consommer durablement, ce qui freine la croissance interne et accroît la dépendance aux aides sociales. La Drees souligne que, dans l’UE, le taux de pauvreté dépasse 20 % dans certains pays du Sud et de l’Est, comme l’Espagne, l’Italie, la Lettonie, la Roumanie, la Bulgarie et l’Estonie, ce qui met en perspective la situation française : si elle reste en dessous de la moyenne, elle doit anticiper les effets économiques d’un pouvoir d’achat qui stagne ou régresse pour les classes modestes.
Les données récentes de l’Insee confirment cette tendance : l’inflation a particulièrement touché les ménages modestes, augmentant leur vulnérabilité et accentuant les inégalités sociales.
Le recul du niveau de vie des personnes modestes alerte sur la nécessité d’un soutien ciblé et de mesures fiscales adaptées
souligne la Drees. Pour l’économie, cela signifie un risque accru de consommation freinée, avec un impact direct sur les PME et le marché immobilier, secteurs sensibles aux revenus des ménages moyens.
👁️ L’œil de l’expert
Si la France se distingue par un taux de pauvreté relativement bas, la croissance des ménages modestes constitue un signal d’alerte économique. À court terme, le pouvoir d’achat et le niveau de vie seront des facteurs déterminants pour la dynamique de la consommation, tandis qu’à moyen terme, l’État devra arbitrer entre aides sociales, fiscalité et stimulation économique pour éviter que cette frange de la population ne bascule vers la pauvreté.
Autrement dit, moins de pauvres, mais plus de vulnérables : un paradoxe français qui pourrait peser sur la croissance et la stabilité financière du pays si aucune politique proactive n’est mise en place