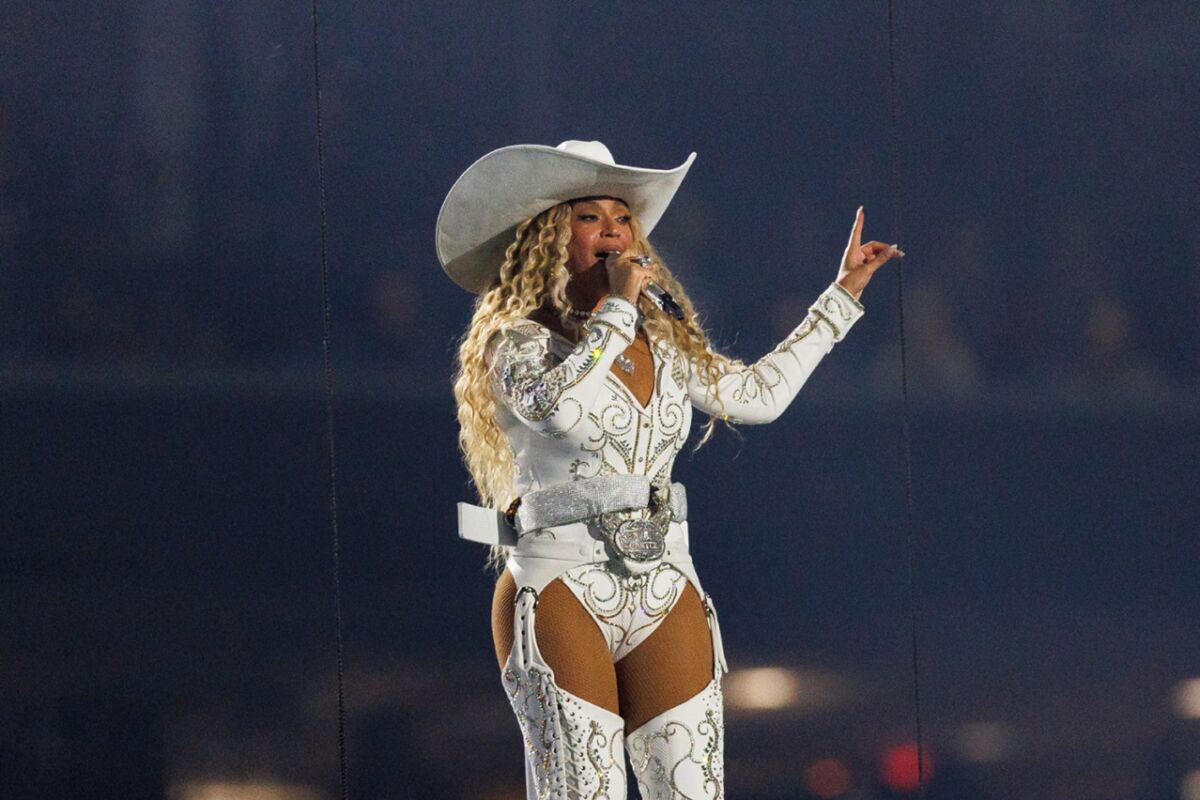La planète s’arrache les peluches Labubu, ces petits monstres aux grands yeux et aux dents acérées devenus objets de collection. Vendues entre 12 et 15 € – bien plus pour les éditions limitées –, elles créent des files d’attente interminables et alimentent un marché parallèle florissant de contrefaçons. Mais derrière ce succès mondial se cache une autre réalité : celle d’ouvrières chinoises, souvent sexagénaires, qui peinent à joindre les deux bouts. Entre marges confortables pour les marques et rémunérations dérisoires pour la main-d’œuvre, l’écart économique interroge.
🏭 Une production à bas coût
Dans le sud de la Chine, des milliers de femmes, âgées de plus de 60 ans, participent à la chaîne de fabrication des figurines et peluches Labubu. Certaines travaillent depuis leur domicile, armées d’un simple couteau pour retirer les excédents de plastique. « À raison de 1 500 pièces par jour, elle touche seulement 50 à 60 yuans, soit environ 6,50 € », rapporte Shenzhen Weideguang, cité par Courrier International.
Le calcul est saisissant : chaque figurine lui rapporte 0,035 €, alors que le produit fini est revendu près de 400 fois ce prix. Dans les villages voisins, d’autres ouvrières cousent les costumes miniatures des peluches pour quelques centimes, tandis qu’en usine, certaines reçoivent 5 000 à 6 000 yuans par mois (600 à 700 €). À titre de comparaison, les ouvriers qualifiés chargés du thermoformage atteignent 10 000 yuans (1 200 €).
Ce modèle économique repose donc sur une main-d’œuvre bon marché, permettant aux marques de dégager des marges substantielles sur des produits devenus objets de spéculation. La rareté, organisée par des séries limitées et la gestion des stocks, amplifie encore la valeur de revente.
⚖️ Un système qui reste fragile
La demande mondiale explosive pour les Labubu entraîne une pression intense sur les chaînes de production. Mais cette croissance cache des fragilités structurelles. Les ouvrières n’ont aucune sécurité de revenu : quand la frénésie se calmera, elles passeront à une nouvelle figurine, sans perspective d’amélioration salariale.
Ce déséquilibre illustre la dépendance du secteur des jouets et produits dérivés à une logique de main-d’œuvre sous-payée et flexible, où les marges reposent sur la précarité. Or, dans un contexte où la Chine connaît un ralentissement économique et une hausse du coût de la vie, ce modèle pourrait se heurter à des tensions sociales croissantes.
D’autant que l’écart entre le prix payé par le consommateur et le revenu versé à l’ouvrière devient difficilement justifiable. Comme le souligne Courrier International, ces femmes « n’ont même jamais vu le produit fini », révélant une déconnexion totale entre la valeur créée et la valeur captée.
👁 L’œil de l’expert
Le cas Labubu est révélateur d’un capitalisme de l’attention : des produits simples, valorisés par une communication virale et un sentiment de rareté, permettant des marges exceptionnelles. Mais ce succès repose sur une exploitation quasi invisible d’ouvriers âgés, qui assurent l’assemblage pour des salaires bien en deçà des standards de subsistance.
Pour les marques, la question n’est pas seulement économique mais aussi réputationnelle : dans un monde où la traçabilité et l’éthique deviennent des critères d’achat, les consommateurs occidentaux pourraient exiger davantage de transparence.
Pour les autorités chinoises, le défi est double : maintenir une industrie compétitive à l’export tout en évitant que les inégalités criantes ne se transforment en source d’instabilité sociale.
En somme, derrière chaque peluche Labubu se cache un paradoxe : un objet de désir mondialisé, mais aussi le symbole des déséquilibres économiques et sociaux d’un système globalisé.