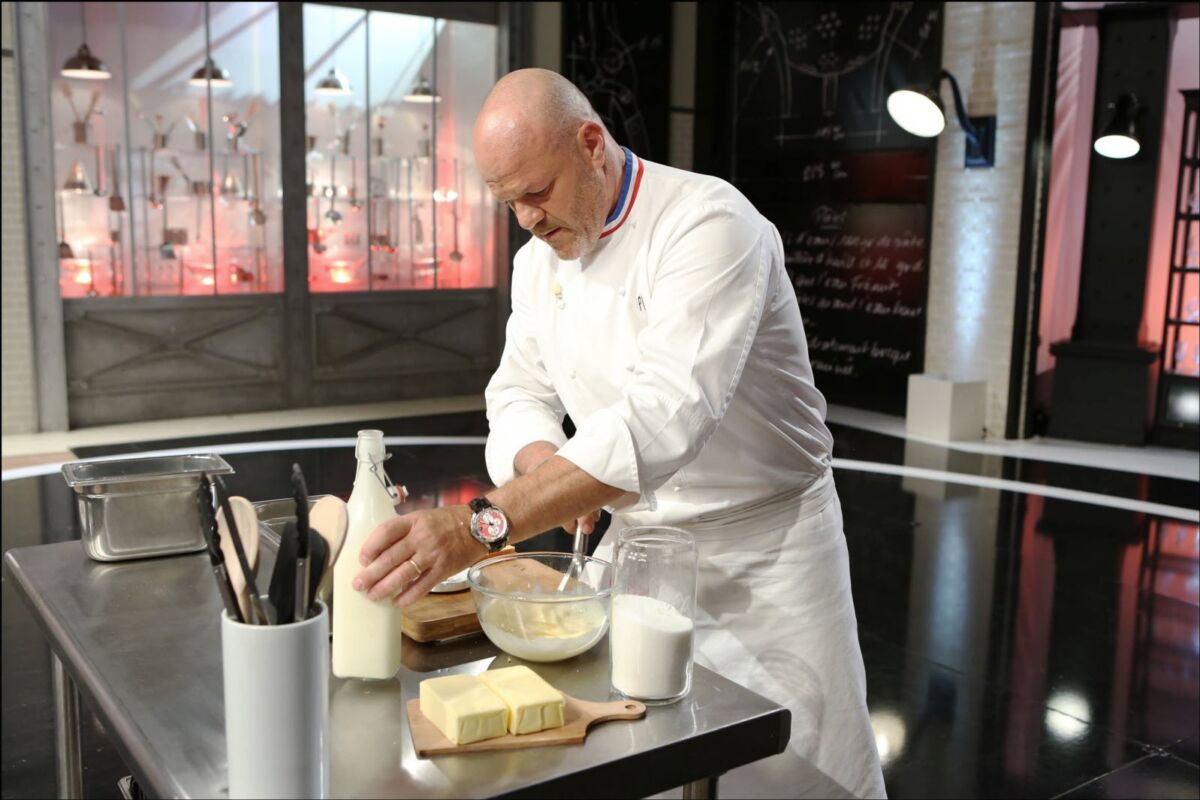C’est un séisme commercial et politique à Paris : alors que Shein inaugurait ce mercredi 5 novembre son premier magasin physique mondial au Bazar de l’Hôtel de Ville (BHV), le gouvernement français a annoncé l’ouverture d’une procédure de suspension contre la plateforme de fast-fashion chinoise.
Une décision « sur instruction du Premier ministre », selon le communiqué du ministère de l’Économie, qui intervient dans un contexte explosif : Shein est visé par une enquête du parquet de Paris pour la vente de produits pédopornographiques sur son site.
Le choc est d’autant plus violent que l’entreprise, déjà critiquée pour ses conditions de production et son empreinte carbone, voyait dans cette implantation physique un jalon stratégique de son expansion européenne. Désormais, c’est son modèle économique même qui vacille sous le feu des autorités et de l’opinion publique.
⚖️ Suspension et audition parlementaire imminente
Le ton du gouvernement ne laisse place à aucune ambiguïté. Dans un communiqué transmis à la presse, Bercy indique que la procédure de suspension sera maintenue « le temps nécessaire pour que la plateforme démontre sa conformité aux lois françaises ».
Un point d’étape sous 48 heures est prévu, signe d’une fermeté politique rare vis-à-vis d’un acteur étranger du e-commerce.
Cette décision intervient alors que les dirigeants de Shein sont convoqués le 18 novembre par la mission parlementaire d’information. Le député Antoine Vermorel-Marques (LR) a exigé que la société « rende des comptes sur les profits réalisés grâce à la vente de poupées pédopornographiques ». Il demande également la transmission à la justice de la liste des clients concernés.
Le parlementaire dénonce un scandale d’État.
Dans le même temps, la DGCCRF a adressé quatre signalements au parquet concernant Shein, AliExpress, Temu et Wish, mettant en cause la vente d’objets sexuels à apparence d’enfants et leur accessibilité aux mineurs. Un front judiciaire qui s’élargit et menace l’ensemble du modèle des marketplaces mondialisées.
🏬 Rupture avec les Galeries Lafayette et révolte des marques françaises
Le scandale ne se limite plus au terrain juridique. Il s’est étendu au secteur du commerce de détail, provoquant une onde de choc parmi les grandes enseignes.
La Société des Grands Magasins (SGM), gestionnaire du BHV et partenaire historique des Galeries Lafayette, avait prévu d’installer Shein dans plusieurs villes françaises (Dijon, Reims, Limoges, Grenoble, Angers).
Mais face à la polémique, le groupe Galeries Lafayette a rompu son partenariat avec la SGM, dénonçant le positionnement moralement incompatible de Shein :
Leur modèle d’ultra fast-fashion contredit nos valeurs et notre engagement pour une mode responsable
a indiqué la direction dans un communiqué. La décision est lourde : sept grands magasins vont perdre l’enseigne Galeries Lafayette dans les prochaines semaines, avant d’être rebaptisés sous une autre marque.
Le désengagement gagne aussi les créateurs français. Dans un communiqué de la marque, la styliste Agnès b. a annoncé son retrait du BHV, jugeant l’installation de Shein « contraire à l’éthique de la maison » :
Je suis archi-contre cette fast-fashion qui détruit les emplois et la planète. Moi, je crois aux vêtements faits pour durer.
Son départ s’ajoute à celui d’une dizaine d’autres enseignes, transformant l’inauguration du magasin Shein en véritable naufrage d’image.
👁️ L’œil de l’expert
Au-delà du scandale moral, c’est tout un modèle économique qui est remis en question.
Pour Lucile Deschamps, économiste spécialiste du commerce international, « l’affaire Shein marque un tournant dans la régulation européenne du e-commerce ». La France, en enclenchant une procédure de suspension, pose un précédent juridique qui pourrait inspirer Bruxelles dans le cadre de la directive sur les contenus illicites et la transparence algorithmique.
Sur le plan financier, la rupture avec les Galeries Lafayette et la défiance des marques fragilisent l’implantation physique de Shein, pierre angulaire de sa stratégie d’expansion hors ligne.
Entre enquête judiciaire, perte de partenaires et boycott public, le coût réputationnel pourrait se traduire par des pertes à moyen terme sur le marché européen, évalué à plusieurs centaines de millions d’euros selon des analystes du secteur.
En somme, la « fast-fashion » à la chinoise se heurte de plein fouet à la lente mais ferme exigence française d’éthique, de transparence et de durabilité.