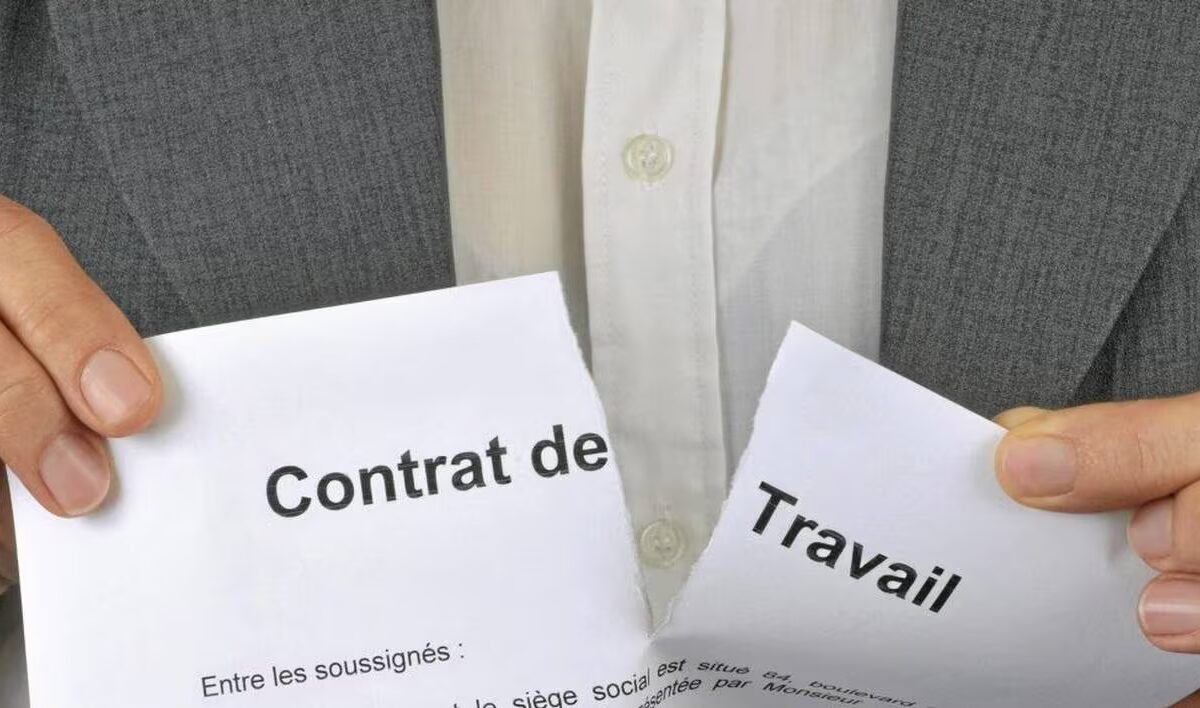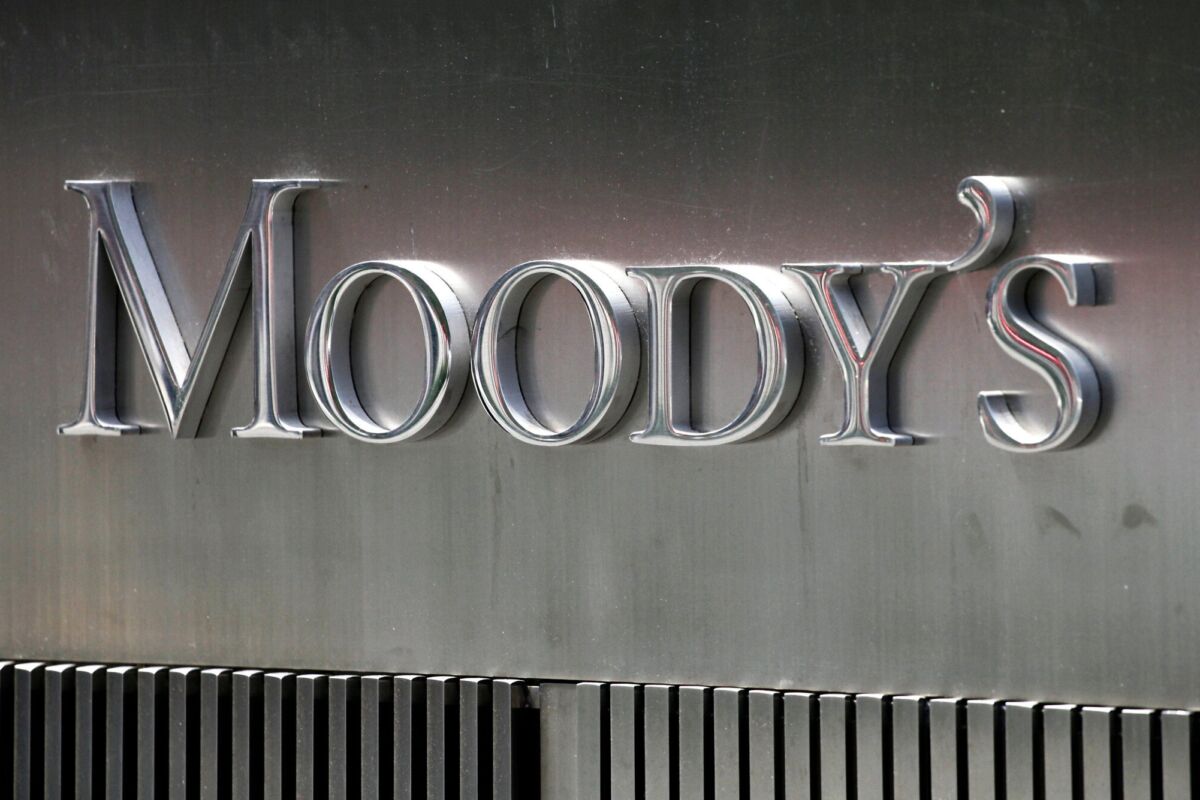Alors que les violences conjugales restent un sujet majeur de santé publique, une dimension longtemps passée sous silence s’impose désormais dans le débat : les violences économiques. En France, près d’une femme sur quatre déclare en avoir déjà été victime. Ce mode d’emprise, subtil mais redoutablement efficace, enferme les victimes dans une dépendance financière qui rend toute séparation difficile, voire impossible.
Avec l’émergence de nouvelles données, la mobilisation des banques, une évolution juridique en cours et la multiplication de témoignages récents, cette violence longtemps minimisée apparaît aujourd’hui comme un enjeu social majeur.
⚠️ Une violence silencieuse mais massive
Un phénomène de grande ampleur, encore sous-estimé – Selon une enquête Ifop pour la FNSF (Fédération Nationale Solidarité Femmes), 24 % des femmes en couple ont déjà subi des violences économiques. Et parmi elles, près de 3 femmes sur 10 ne disposent pas d’un compte bancaire personnel, une réalité qui complique considérablement leur autonomie.
Les associations confirment l’ampleur du phénomène : selon une étude menée par Solidarité Femmes, 76 % d’entre elles constatent régulièrement des situations où un conjoint interdit à la femme de travailler, une stratégie visant à installer une dépendance totale.
L’argent comme outil de domination – Les violences économiques prennent plusieurs formes comme le contrôle intégral des comptes bancaires, la privation de moyens de paiement, la confiscation du salaire ou pire encore l’interdiction de travailler. On retrouve aussi la mise sous tutelle des dépenses du foyer, enfin la contraction de dettes au nom de la victime.
Certaines pratiques s’étendent même après la rupture : 59 % des associations déclarent que les violences économiques perdurent après la séparation, via des manipulations financières, des menaces liées aux pensions alimentaires, ou des crédits contractés frauduleusement.
Des témoignages récents qui révèlent l’ampleur du problème – Pour mieux comprendre ces mécanismes, plusieurs témoignages récents mettent en lumière la gravité du phénomène. Le Monde rapporte le cas de femmes privées d’accès à leur compte bancaire ou contraintes de demander chaque dépense à leur conjoint :
Le sujet est longtemps resté l’angle mort des violences conjugales
explique Mine Günbay, directrice générale de la Fédération nationale Solidarité Femmes au journal Le Monde, en 2024.
ONU Femmes France souligne que ces violences sont un outil de domination : Caroline Soulié, membre du Comité Exécutif de BNP Paribas Personal Finance, rappelle que confisquer une carte bancaire, bloquer des comptes ou empêcher l’accès aux ressources constitue une forme courante de contrôle économique. Dans 90 % des cas, ces abus empêchent la victime de quitter son conjoint.
Ces témoignages montrent que la violence économique est une stratégie de contrôle durable. Elle peut se poursuivre même après la séparation, laissant la victime dans une situation précaire sur le plan financier et personnel.
👊 Une prise de conscience institutionnelle
Les banques en première ligne pour offrir une autonomie financière – Ces dernières années, plusieurs groupes bancaires ont développé des dispositifs concrets pour protéger les victimes. Le groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale a, par exemple, organisé le lancement d’un compte discret et sécurisé, permettant d’ouvrir un compte confidentiel non accessible par le conjoint, même en cas de co-titularité bancaire antérieure. de son côté, La Banque Postale a procédé à l’extension en 2025 d’un service d’ouverture de compte express en 24h, spécifiquement destiné aux victimes de violences économiques.
Enfin, la Banque de France a mis en ligne une « foire aux questions officielle« sur les violences économiques intrafamiliales, avec les démarches pour reprendre la main sur ses comptes, situations litigieuses ou contestations d’opérations.
Pour la première fois, le secteur bancaire reconnaît officiellement l’existence de ce type de violence et adapte ses services à une urgence sociale.
Une évolution juridique attendue : le contrôle coercitif au cœur des débats – En janvier 2025, l’Assemblée nationale a examiné l’introduction du délit de “contrôle coercitif”, déjà reconnu dans plusieurs pays anglo-saxons (dont le Royaume-Uni). Cette notion englobe les violences psychologiques, matérielles et économiques.
L’objectif : permettre aux forces de l’ordre et aux magistrats de sanctionner le contrôle financier dès les premiers signes, avant qu’il ne s’étende ou ne devienne irréversible.
La vigilance des associations : entre mobilisation et fragilité des moyens – Si les dispositifs progressent, les associations alertent sur un paradoxe préoccupant : leurs financements diminuent au moment même où les signalements augmentent. En 2025, plusieurs structures locales Solidarité Femmes ont tiré la sonnette d’alarme, évoquant une hausse de 20 à 30 % des demandes d’aide, sans augmentation budgétaire correspondante.
Le rôle des organismes internationaux – ONU Femmes France rappelle que 90 % des violences économiques empêchent les victimes de quitter leur agresseur, soulignant leur rôle central dans la spirale de la violence conjugale.
👁 L’œil de l’expert
Les violences économiques représentent une forme de domination conjugale insidieuse : invisibles aux yeux de beaucoup, difficiles à documenter, mais aux effets profondément destructeurs. Elles sapent la confiance, restreignent l’autonomie et maintiennent des milliers de femmes dans des relations oppressives.
Pour lutter efficacement contre ce fléau, il est indispensable de conjuguer plusieurs actions : sensibiliser largement le grand public, former les professionnels de la banque et du secteur social, renforcer la législation, et soutenir financièrement les structures d’accompagnement. Comme le souligne Mine Günbay au journal Le Monde en 2024, « reconnaître ces violences est le premier pas vers la protection et la libération des femmes concernées ».
Ce n’est qu’en associant efforts juridiques, dispositifs économiques et accompagnement social que les victimes pourront retrouver le contrôle de leur vie – et surtout, recouvrer leur indépendance financière.