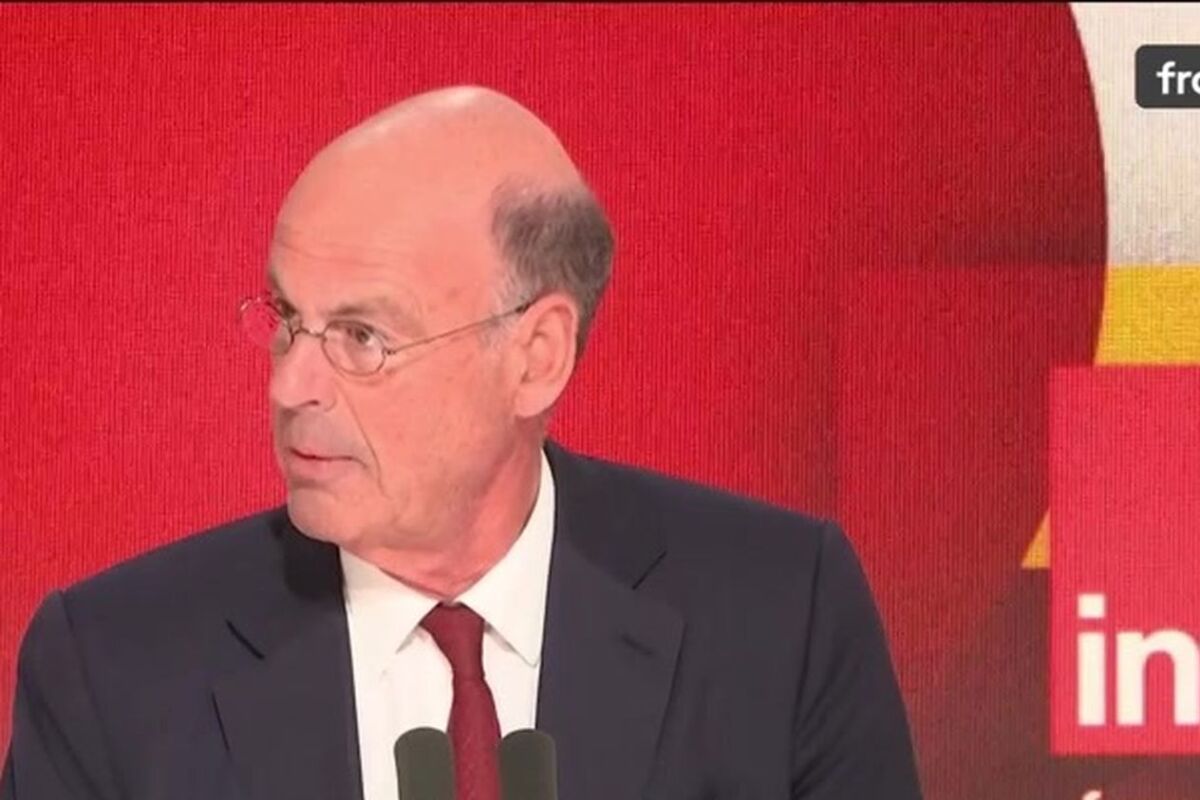En France, les comptes d’épargne ouverts au nom d’un enfant mineur constituent un patrimoine qui lui appartient intégralement dès l’ouverture, quel que soit l’âge du bénéficiaire ou la provenance des fonds. Cependant, les parents, en tant que représentants légaux, conservent la responsabilité de leur gestion dans le cadre de l’administration légale, tout en devant garantir que toute utilisation respecte l’intérêt de l’enfant.
👶 Une démarche d’éducation et d’avenir
Un enfant mineur peut légalement avoir un compte bancaire ou un livret d’épargne (Livret A, Livret Jeune, PEL, assurance-vie), ouvert par ses parents ou représentants légaux. L’ouverture peut se faire dès la naissance pour un Livret A ou un compte d’épargne. À 12 ans, avec accord parental, l’enfant peut ouvrir un Livret Jeune, et à 16 ans, il peut disposer d’un compte courant avec carte bancaire, sauf opposition des parents.
Les parents choisissent souvent d’ouvrir un compte pour leur enfant afin de constituer une épargne pour ses projets futurs, bénéficier des avantages fiscaux des livrets réglementés, transmettre des notions de gestion budgétaire et sécuriser les dons ou héritages reçus. Une démarche utile pour préparer son avenir et encourager son autonomie financière.
👨👩👧 Parents administrateurs, pas propriétaires
Lorsqu’un compte bancaire ou un livret est ouvert au nom d’un enfant mineur, les parents n’en sont pas les propriétaires, même s’ils en assurent la gestion. Conformément au Code civil, ils interviennent en tant qu’administrateurs légaux des biens du mineur. Cela signifie qu’ils doivent gérer les sommes déposées dans l’intérêt exclusif de l’enfant, et non pour leur propre usage.
Cette responsabilité implique une gestion prudente, sécurisée et désintéressée. Les parents n’ont pas le droit de puiser dans ces fonds pour leurs besoins personnels. De plus, lorsqu’il devient majeur, l’enfant peut demander des comptes sur l’utilisation de l’argent qui lui appartenait. En cas de contestation, les parents peuvent être tenus de justifier leur gestion. Cette règle vise à protéger le patrimoine du mineur et à garantir que l’épargne accumulée serve réellement ses projets futurs.
Olivier Seban, expert financier souligne :
Les parents sont les premiers gardiens du patrimoine de leurs enfants ; leur rôle est de protéger et non d’utiliser ces ressources à leur profit.
🏧 Les conditions de retrait
Des retraits peuvent être faits, mais uniquement s’ils servent à couvrir les besoins de l’enfant : frais de scolarité, logement, santé, activités éducatives, etc. Dans ce cadre, les intérêts générés par l’épargne peuvent également être utilisés. Pour les dépenses courantes, un seul parent peut faire un retrait. En revanche, pour des opérations plus importantes comme la clôture du compte ou un retrait total l’accord des deux parents est nécessaire. Et si la somme doit être utilisée pour une dépense exceptionnelle, comme un achat immobilier ou des études à l’étranger, il faut obtenir l’autorisation d’un juge.
Si l’argent de l’enfant est utilisé de façon abusive, les parents peuvent être tenus responsables. Une fois majeur, l’enfant a le droit de demander des comptes sur la gestion de son épargne. En cas de problème, il peut engager une action en justice, dans un délai de cinq ans après ses 18 ans.
👁 L’œil de l’expert : La protection des enfants
En France, la législation protège rigoureusement l’épargne des enfants mineurs. Si les parents peuvent administrer les comptes de leur enfant, c’est sous une stricte surveillance juridique. Tout usage des fonds doit répondre à l’intérêt direct du mineur. Les institutions financières ont elles aussi un devoir de vigilance face à d’éventuels abus. À l’heure où l’éducation financière devient cruciale, ce cadre légal permet aussi une transmission progressive de l’autonomie économique à l’enfant.