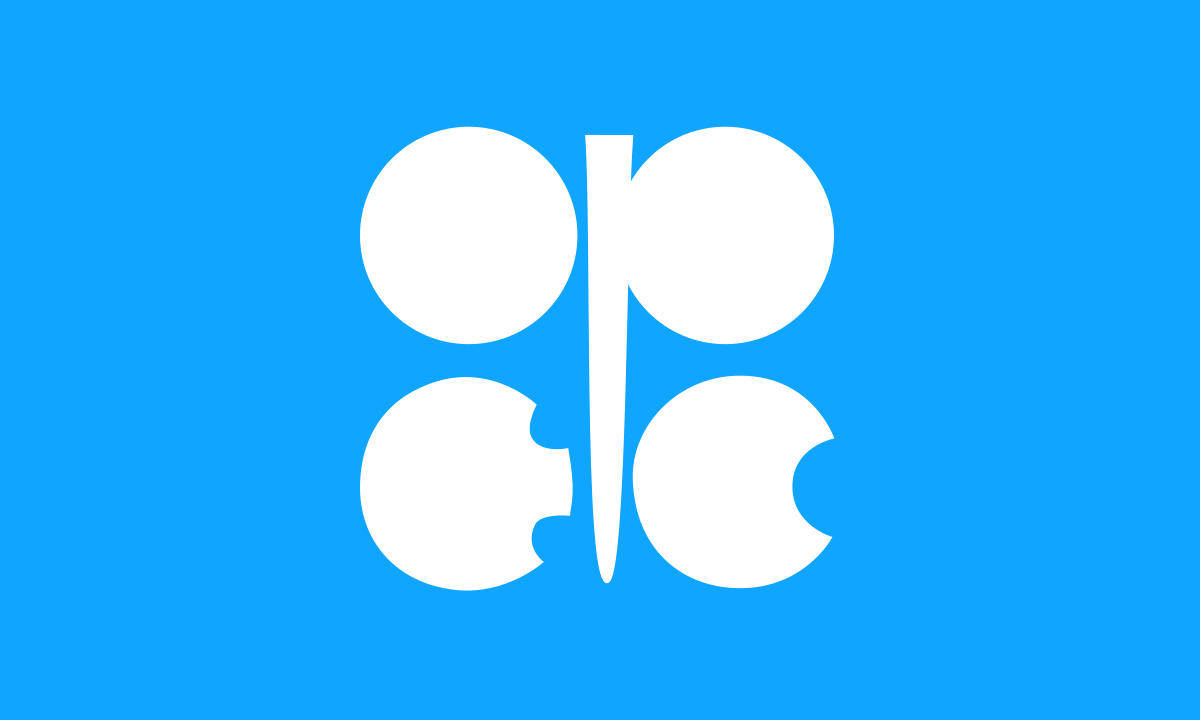Alors que le baril de Brent a atteint son plus bas niveau depuis mai 2021, les prix à la pompe, eux, ne suivent pas la même tendance. En ce début d’octobre, le diesel s’affiche à 1,628 €/L et le SP95-E10 à 1,695 €/L, des niveaux presque équivalents à ceux d’il y a un an, malgré une chute marquée des cours mondiaux du brut. Un paradoxe qui alimente la colère des automobilistes, mais qui s’explique par des facteurs bien plus structurels qu’il n’y paraît.
📈 Les véritables moteurs de la hausse
Si le prix du baril est tombé autour de 68 dollars, son niveau le plus faible depuis plus de trois ans, la facture à la pompe ne s’est pas allégée. La raison principale tient dans le poids croissant de la fiscalité énergétique.
En France, les taxes représentent près de 60 % du prix final d’un litre de carburant. Entre la TICPE (Taxe Intérieure sur la Consommation de Produits Énergétiques) et la TVA, les prélèvements publics alimentent chaque année entre 40 et 45 milliards d’euros de recettes pour l’État. À cela s’ajoute une hausse notable des certificats d’économies d’énergie (CEE), qui ont renchéri le litre d’environ six centimes depuis 2021.
Mais la fiscalité n’est pas seule en cause. Le raffinage et les coûts logistiques ont eux aussi explosé. Selon les données du secteur, le coût de transformation du brut en carburant a augmenté d’environ six centimes par litre sur la même période. Une hausse alimentée par les tensions sur l’énergie, le coût du transport maritime et les contraintes environnementales imposées aux raffineries européennes.
Autrement dit, même avec un pétrole « bon marché », les marges industrielles et fiscales suffisent à maintenir un prix final élevé.
⛽ Une stratégie d’attente qui retarde la baisse des prix
Au-delà des taxes et des coûts de production, un autre acteur pèse dans l’équation : les distributeurs de carburant. Selon Valérie Mignon, membre du Cercle des économistes et professeure d’économie à l’Université Paris Nanterre :
Si le prix du brut diminue, les distributeurs peuvent différer stratégiquement la répercussion de la baisse du prix du baril sur les prix à la pompe.
Autrement dit, les enseignes attendent parfois de confirmer la durabilité de la baisse avant d’ajuster leurs tarifs. Cette latence stratégique s’appuie sur un constat simple : les consommateurs ne disposent pas toujours d’une vision claire du lien entre le prix du baril et le prix à la pompe.
Les automobilistes ne savent pas si les fluctuations proviennent des variations du brut ou des marges de distribution
ajoute Valérie Mignon. Cette asymétrie d’information permet aux distributeurs de préserver leurs marges en période de volatilité, tout en profitant d’un contexte où la transparence sur les coûts réels reste limitée.
👁 L’œil de l’expert : le prix de la dépendance
Le marché des carburants illustre parfaitement les tensions entre logique économique, impératif fiscal et contraintes industrielles. Même avec un pétrole à bas prix, les taxes, le raffinage et les marges commerciales neutralisent toute retombée positive immédiate pour les consommateurs.
Dans un contexte de transition énergétique, cette rigidité des prix pose un enjeu majeur : comment maintenir une fiscalité verte sans étrangler le pouvoir d’achat ? Tant que la dépendance de l’État aux recettes issues des carburants perdurera, les automobilistes risquent de payer cher leur plein, même lorsque le baril dégringole.