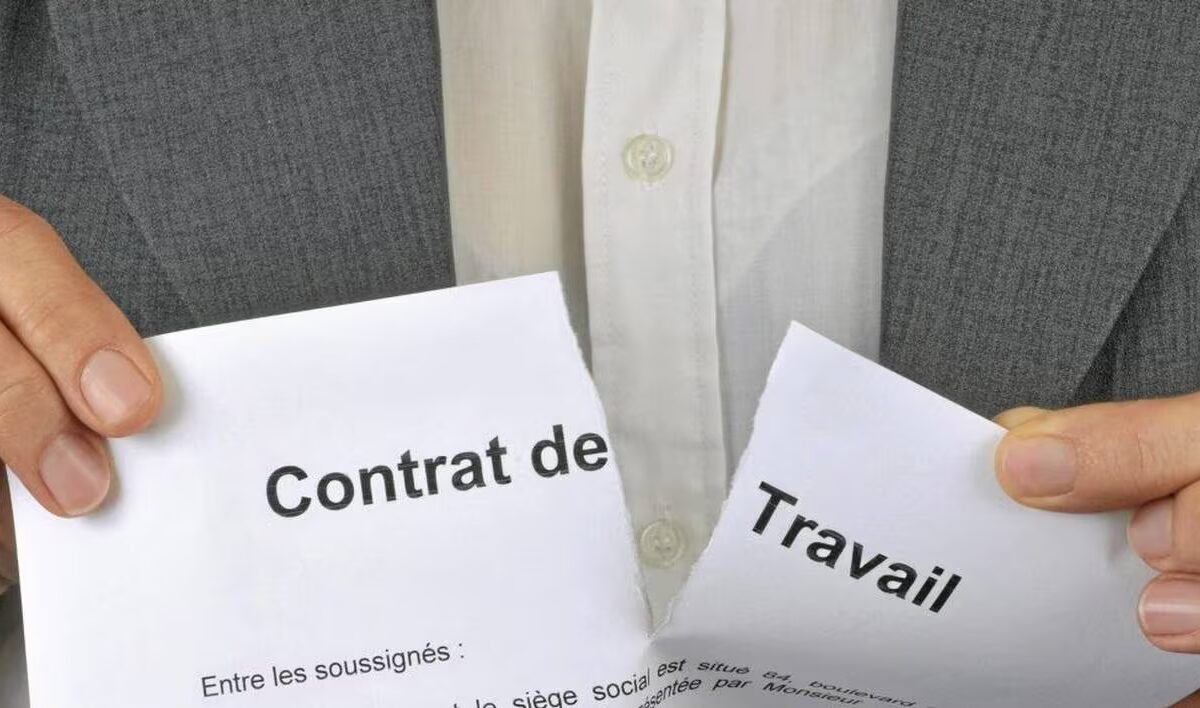Mal rémunérés, peu écoutés et souvent épuisés : les enseignants français affichent un niveau de satisfaction parmi les plus faibles des pays de l’OCDE. Selon la dernière enquête internationale TALIS 2024, publiée ce mardi par l’Organisation de coopération et de développement économiques, la situation du corps enseignant en France est jugée « préoccupante ». Entre salaires stagnants, formation déficiente et conditions de travail dégradées, le constat est sévère pour un secteur clé de l’économie du savoir. Derrière ces chiffres, se dessine un malaise profond qui interroge sur l’attractivité du métier et sur la capacité du système éducatif français à se réinventer.
💼 Les professeurs français décrochent du reste de l’OCDE
Selon l’étude de l’OCDE, seuls 79 % des enseignants français se déclarent satisfaits de leur métier, contre 90 % en moyenne dans l’OCDE. La France rejoint ainsi le Japon dans le bas du classement. Un chiffre qui traduit une perte de confiance durable dans un métier longtemps perçu comme une vocation.
Mais c’est surtout la faible valorisation sociale de la profession qui frappe : à peine 4 % des enseignants estiment leur travail reconnu par la société, contre 20 % en moyenne dans l’ensemble des pays étudiés. En 2018, ils étaient encore 7 %.
Les résultats français sont préoccupants, sur la formation, la coopération entre enseignants, et la satisfaction dans le métier
explique Éric Charbonnier, expert éducation à l’OCDE. Le niveau de rémunération figure également parmi les principales sources d’insatisfaction. Seuls 27 % des enseignants du secondaire et 22 % du primaire se disent satisfaits de leur salaire, là où 40 % de leurs homologues de l’OCDE l’affirment. En parallèle, le coût de la vie en France et l’érosion du pouvoir d’achat accentuent ce sentiment de déclassement.
Le fossé entre effort et récompense est donc flagrant. Moins reconnus, moins payés et plus sollicités, les enseignants français peinent à percevoir les avantages de leur métier : seulement 54 % estiment que les bénéfices de leur fonction compensent les inconvénients.
Il faut rouvrir le grand chantier du métier d’enseignant
plaide Éric Charbonnier (OCDE), qui appelle à repenser les politiques salariales et à renforcer la valorisation du corps enseignant dans la société.
⚙️Un système à bout de souffle
Les chiffres de TALIS 2024 confirment un autre problème structurel : la formation des enseignants. Seule la moitié des jeunes professeurs du secondaire jugent avoir été correctement préparés à la pratique pédagogique, contre 34 % dans le primaire. Des données très inférieures à la moyenne de l’OCDE.
Nous avons de vraies défaillances dans la formation initiale
reconnaît encore Eric Charbonnier, qui s’interroge sur les effets de la réforme ramenant le concours d’enseignement à bac+3 au lieu de bac+5. Si cette mesure pourrait renforcer l’attractivité du métier, elle risque aussi de fragiliser la qualité de la préparation.
Autre sujet d’inquiétude : la montée du stress professionnel. En 2024, 18 % des enseignants disent ressentir un stress élevé, contre 11 % en 2018. Les causes ? Des réformes successives, une charge administrative lourde, et la complexité croissante des classes.
Près de 80 % des enseignants rapportent faire face à des problèmes de discipline, et consacrent en moyenne 18 % de leur temps de cours à gérer ces situations.
Les classes hétérogènes deviennent la norme : 74 % des professeurs travaillent dans des écoles où au moins 10 % des élèves ont des besoins éducatifs particuliers, contre 42 % en 2018. Le nombre d’établissements accueillant des élèves réfugiés a lui aussi bondi, de 44 % à 65 %.
Enfin, la formation continue reste lacunaire face aux nouveaux défis technologiques : seuls 9 % des enseignants ont reçu une formation sur l’intelligence artificielle en 2024.
Et la coopération entre professeurs reste minimale : en France, on y consacre à peine deux heures par semaine, contre trois à cinq heures dans d’autres pays de l’OCDE.
👁️ L’œil de l’expert : un système à la croisée des chemins
Le constat de l’OCDE met en lumière un déséquilibre économique et humain au cœur du modèle éducatif français. L’État dépense plus, mais sans générer une amélioration du bien-être enseignant ni de l’efficacité pédagogique.
Le problème n’est pas seulement budgétaire : il touche à la reconnaissance sociale du métier, à la qualité de la formation et à la capacité d’adaptation du système.
L’attractivité du métier d’enseignant conditionne pourtant la performance économique future du pays : sans enseignants motivés, formés et valorisés, la France risque de voir se creuser son retard éducatif et productif.
Pour redonner confiance, une refonte globale s’impose : meilleure rémunération, accompagnement des carrières, montée en compétences numériques et inclusion renforcée. Sans cela, la crise de vocation dans l’enseignement pourrait devenir un enjeu structurel majeur du XXIe siècle.