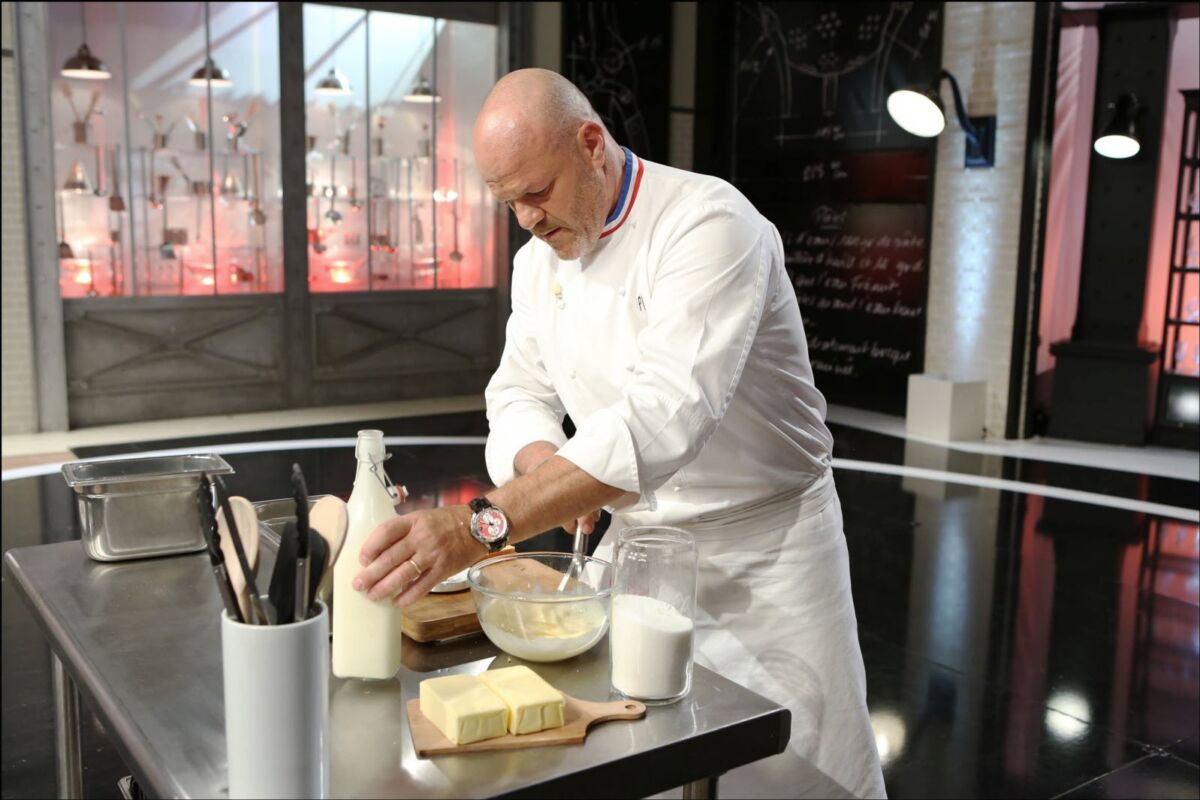C’est le grand écart permanent du consommateur français : indigné le matin, acheteur compulsif le soir. Selon une récente étude menée par L’Hémicycle et Norstat, 70 % des Français déclarent acheter des vêtements issus de la fast fashion, et 100 % l’ont fait au moins une fois ces douze derniers mois.
Un constat troublant dans un pays qui se dit de plus en plus sensible à la transition écologique et à la consommation responsable. Derrière les slogans « durables » et les promesses de transparence, la réalité économique reste implacable : le prix, le style et la rapidité d’accès demeurent les véritables moteurs d’achat.
Comme le résume avec lucidité Éric Revel, directeur de la rédaction de L’Hémicycle,
Les Français savent, mais achètent. Ce n’est pas du cynisme : c’est la réalité d’un pays où le pouvoir d’achat et le style l’emportent sur la morale publique.
🛍️ Un phénomène transgénérationnel
Les chiffres sont sans appel : la fast fashion n’est plus une niche, c’est la norme.
Des enseignes comme Zara, H&M, Shein, Primark, Bershka, Temu ou Asos constituent aujourd’hui le socle d’un marché mondialisé et hyperconcurrentiel.
70 % des Français en consomment régulièrement, et la totalité des sondés reconnaît y avoir eu recours au moins une fois sur l’année écoulée. Les 18–35 ans dominent largement cette tendance (88 %), mais les foyers les plus aisés ne sont pas en reste : trois quarts des ménages gagnant plus de 2 500 € mensuels achètent eux aussi ces produits.
Autrement dit, la fast fashion transcende les classes sociales : elle touche aussi bien les étudiants que les cadres supérieurs.
Les femmes, par ailleurs, représentent 78 % des consommatrices régulières, confirmant la féminisation du commerce en ligne et l’impact des plateformes sociales dans les comportements d’achat.
Ce phénomène illustre un basculement culturel : la mode n’est plus saisonnière mais instantanée, rythmée par les algorithmes de TikTok, les drops hebdomadaires et la quête du look “vu sur Insta”.
👗 La bataille perdue de la mode responsable
Lorsqu’on interroge les motivations d’achat, le style arrive en tête (45 %), suivi du prix (30 %) et de la qualité perçue (25 %).
Les considérations éthiques, sociales ou environnementales, elles, ne dépassent pas 7 % des critères cités.
Autrement dit, la conscience écologique s’arrête souvent à la porte du panier d’achat.
Même les scandales médiatiques – pollution, exploitation, ou ventes illégales – ne semblent pas infléchir cette tendance : l’intention d’achat ne recule que d’un point après chaque controverse.
Les labels “verts” censés réconcilier consommation et durabilité — Made in France, Fair Trade, Made in Europe — n’emportent pas non plus la conviction : seulement 26 % des Français les jugent crédibles, beaucoup y voyant du greenwashing marketing plutôt qu’un engagement réel.
L’étude souligne un paradoxe : même parmi ceux qui se disent “attachés à l’éthique”, près de deux tiers ont acheté chez Shein cette année, et plus de 40 % chez Zara ou H&M.
Les comportements semblent donc dictés davantage par la pression du budget et la valorisation du style personnel que par une logique de responsabilité collective.
👁️ L’œil de l’expert
Le constat dressé par les économistes est clair : la fast fashion agit comme un miroir des tensions françaises entre pouvoir d’achat, image sociale et écologie.
Pour Camille Desmoulins, analyste du cabinet Kantar,
La fast fashion n’est pas qu’un choix individuel : c’est une réponse économique à une frustration sociale. Tant que le différentiel de prix entre une robe éthique à 90 € et une robe Shein à 15 € restera aussi massif, le discours vert restera marginal.
Sur le plan macroéconomique, cette tendance pèse lourd : le secteur génère plus de 20 milliards d’euros de ventes par an en France et soutient une consommation immédiate qui stimule à court terme l’activité, mais fragilise les industries textiles locales et aggrave l’empreinte carbone nationale.
La fast fashion, loin d’être un simple phénomène de mode, est devenue un révélateur de la fracture entre les idéaux écologiques et la réalité économique.
Et tant que la tension entre portefeuille et planète ne sera pas résolue, le paradoxe français continuera de s’afficher… sur les étiquettes.