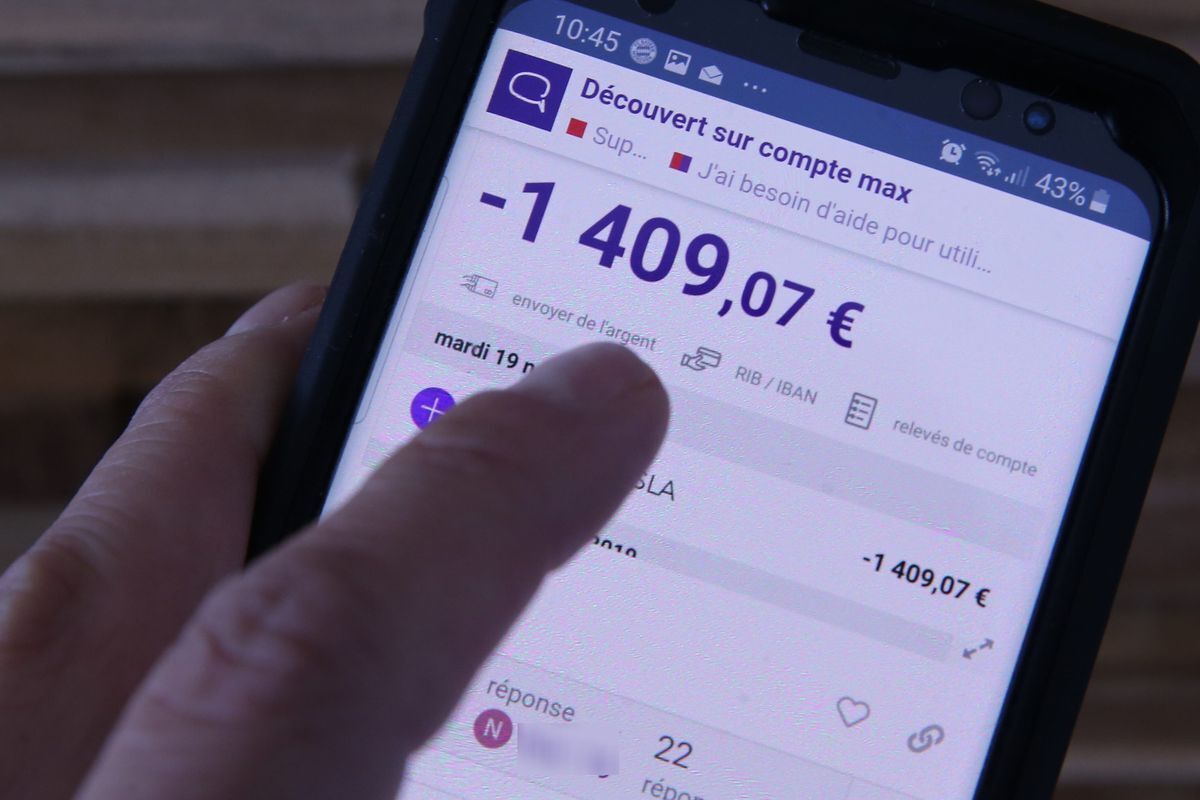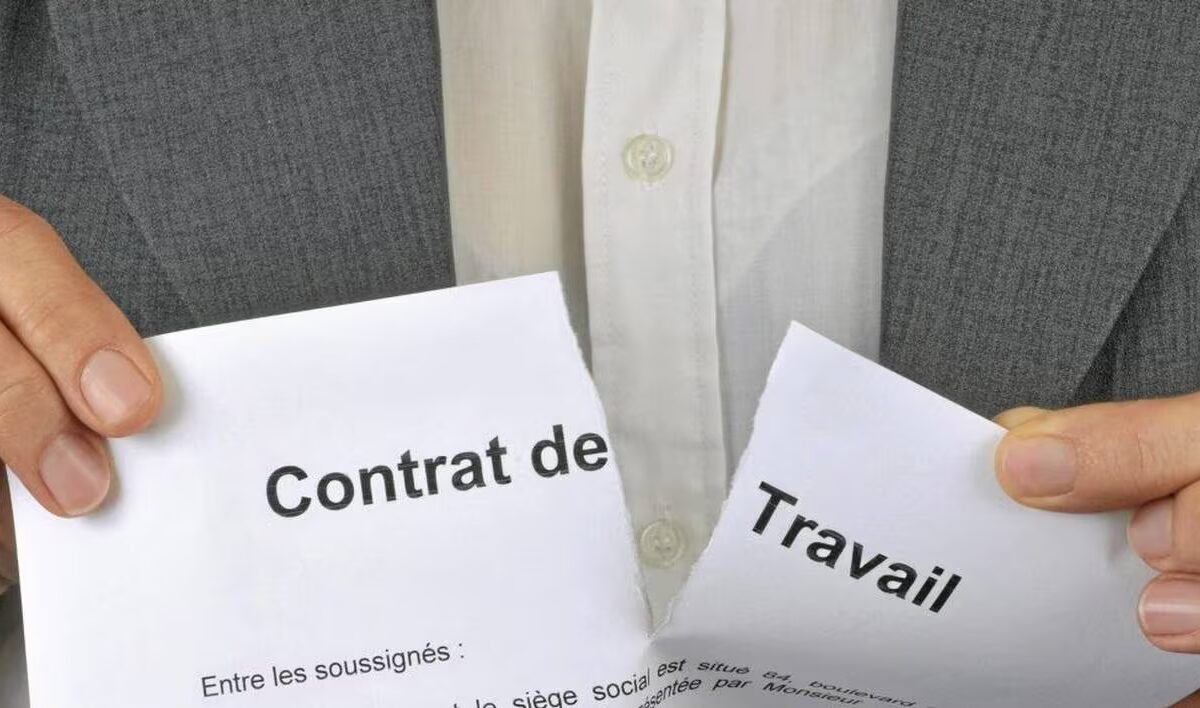Le ciel français s’apprête à connaître une nouvelle zone de turbulence. Le SNCTA, syndicat majoritaire des contrôleurs aériens, a confirmé une grève nationale le 18 septembre, dénonçant un « échec du dialogue social ». Alors que les précédentes mobilisations ont déjà lourdement impacté le trafic intérieur mais aussi européen, cette nouvelle contestation pose une double question : celle du coût économique colossal pour le secteur aérien et celle du modèle de gouvernance interne de la profession.
💸 Des grèves qui coûtent cher
Le SNCTA, qui détient 60 % des voix dans la profession, a annoncé un préavis couvrant l’ensemble de la journée du 18 septembre jusqu’à la fin du service de nuit. Au cœur des revendications : le rattrapage intégral de l’inflation sur les salaires en 2024, mais aussi une meilleure reconnaissance de la spécificité du métier.
Les précédentes mobilisations illustrent l’ampleur des perturbations possibles. Lors de la grève intersyndicale des 3 et 4 juillet 2024, près de 3 000 vols annulés et des centaines de milliers de passagers affectés avaient coûté plusieurs dizaines de millions d’euros aux compagnies aériennes. Ryanair, Air France ou encore easyJet avaient été contraintes de revoir leurs programmes, avec un effet domino sur l’ensemble du réseau européen.
Un expert du secteur explique que « chaque journée de grève des contrôleurs aériens entraîne des pertes directes pour les transporteurs, mais aussi des surcoûts logistiques et une atteinte durable à la confiance des passagers ». L’impact dépasse donc la seule journée de perturbation : il fragilise la rentabilité du transport aérien à court terme et alourdit la facture économique pour l’ensemble de la chaîne (tourisme, hôtellerie, restauration).
⚖️ Gouvernance contestée et climat social délétère
Si la dimension financière est centrale, le malaise va bien au-delà de la seule rémunération. Dans un communiqué, le SNCTA dénonce « une gouvernance du contrôle aérien marquée par la défiance, des pratiques punitives et des méthodes managériales dégradantes ». Le syndicat réclame un changement profond du management au sein de la direction des opérations, jugeant que les conditions de travail se sont détériorées ces dernières années.
Vanessa Hudson, porte-parole du syndicat, précise que le SNCTA a « privilégié le dialogue social et formulé des propositions concrètes à de nombreuses reprises », mais que ce dernier est resté « infructueux, bloquant toute perspective de réforme ». Cette absence de consensus a conduit le syndicat à privilégier le bras de fer, malgré l’effet paralysant sur les aéroports français.
Le précédent du 17 décembre 2024, où des plateformes régionales comme Montpellier ou Perpignan avaient été totalement paralysées, reste encore dans les mémoires. La répétition de tels blocages fragilise la crédibilité de la France comme hub aérien majeur et inquiète Bruxelles, qui observe l’impact transfrontalier de ces grèves sur la circulation européenne.
👁️ L’œil de l’expert : « jeux » inégal
La nouvelle mobilisation du 18 septembre révèle une fracture structurelle entre l’État employeur et ses contrôleurs aériens. Derrière le conflit salarial se cache un enjeu plus large : la modernisation du contrôle aérien français, considéré comme l’un des plus coûteux et complexes d’Europe.
Pour les compagnies aériennes, chaque journée de blocage est un rappel brutal que la dépendance au ciel français reste un risque opérationnel majeur. Pour l’État, il s’agit d’un dilemme : céder aux revendications mettrait en péril l’équilibre budgétaire, mais ignorer le malaise social expose à des paralysies répétées.
Verdict : au-delà des revendications salariales, cette grève illustre l’urgence d’une réforme de gouvernance et de pilotage stratégique dans le contrôle aérien, afin d’éviter que le ciel français ne devienne un frein à la compétitivité européenne.