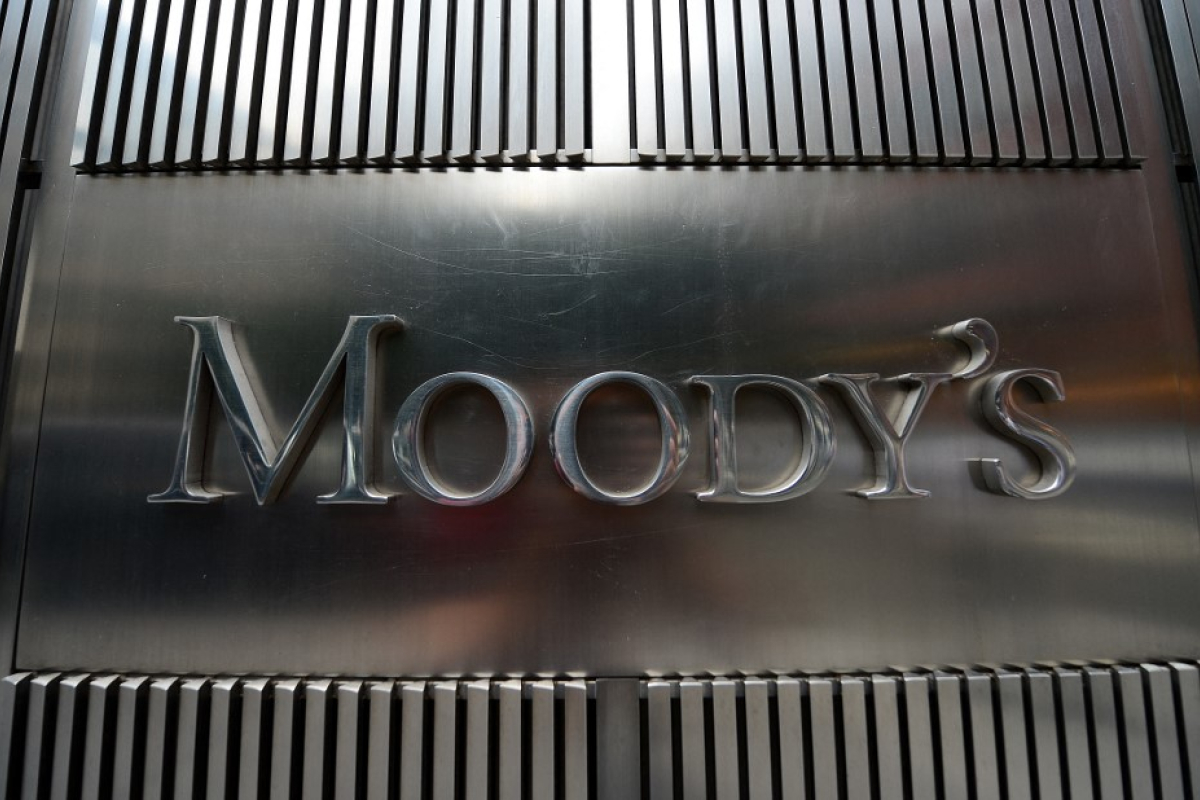Les marchés pétroliers se sont brutalement tendus ce jeudi, au lendemain de l’annonce de nouvelles sanctions américaines visant les géants russes de l’hydrocarbure Rosneft et Lukoil. En réaction, les cours du Brent et du WTI ont bondi de près de 3 % dès les premières heures d’échanges asiatiques, une envolée qui reflète les craintes croissantes de pénurie sur l’offre mondiale de pétrole.
Selon les données de marché, le baril de Brent s’échangeait à 64,35 dollars (+2,81 %), tandis que le WTI américain progressait à 60,18 dollars (+2,87 %).
⛽️ Les dessous d’une flambée des prix
Derrière cette hausse, c’est une véritable partie d’échecs géoéconomique qui se joue.
Le Trésor américain a annoncé mercredi une série de sanctions financières contre les deux mastodontes russes du secteur énergétique, accusant Moscou de refuser tout « engagement sérieux dans un processus de paix » pour mettre fin à la guerre en Ukraine.
Le secrétaire adjoint au Trésor, Scott Bessent, a invité les alliés de Washington à “s’aligner sur ces mesures”, espérant créer un front économique unifié pour isoler davantage l’énergie russe.
Ces décisions ne sont pas sans conséquence : la Russie représente environ 11 % de la production mondiale de brut, derrière les États-Unis et l’Arabie saoudite. En restreignant les exportations russes, les sanctions font craindre une contraction de l’offre globale et alimentent une hausse spéculative sur les marchés à terme.
Pour Kyle Rodda, analyste du cabinet Capital.com, cette politique n’a rien d’improvisé :
L’administration américaine a clairement anticipé ce scénario. La reconstitution récente des réserves stratégiques montre que Washington estimait les prix du pétrole à un niveau suffisamment bas pour absorber un choc d’offre.
Autrement dit, les États-Unis ont préparé le terrain avant d’imposer ces sanctions, afin de limiter leur propre exposition énergétique tout en pesant sur le financement russe. Une stratégie de long terme qui s’inscrit dans une diplomatie économique offensive, notamment vis-à-vis des alliés européens, mais aussi de l’Inde et du Japon, encore dépendants du brut russe.
Cette pression s’exerce dans un contexte délicat : les économies occidentales cherchent à contenir l’inflation énergétique, tandis que les tensions sur le marché mondial du pétrole risquent de raviver la hausse des prix à la pompe et de bousculer les équilibres monétaires.
👁 L’œil de l’expert
Pour Nicolas Meunier, stratégiste en marchés de matières premières, « les sanctions américaines ne sont pas seulement un geste politique : elles traduisent un repositionnement global de la puissance énergétique. Le pétrole redevient un instrument de politique internationale autant qu’un levier économique. »
À court terme, cette tension pourrait soutenir les prix du brut au-delà des 65 dollars le baril, renforçant les marges des producteurs alternatifs (Moyen-Orient, États-Unis, Afrique).
Mais à moyen terme, elle risque de renforcer les liens énergétiques entre la Russie et l’Asie, notamment la Chine, qui pourrait profiter des remises accordées sur le pétrole russe.
En clair : la guerre du pétrole reprend de plus belle. Entre sanctions, rééquilibrages d’alliances et arbitrages stratégiques, les marchés énergétiques entrent dans une phase où géopolitique et économie s’entremêlent plus que jamais.