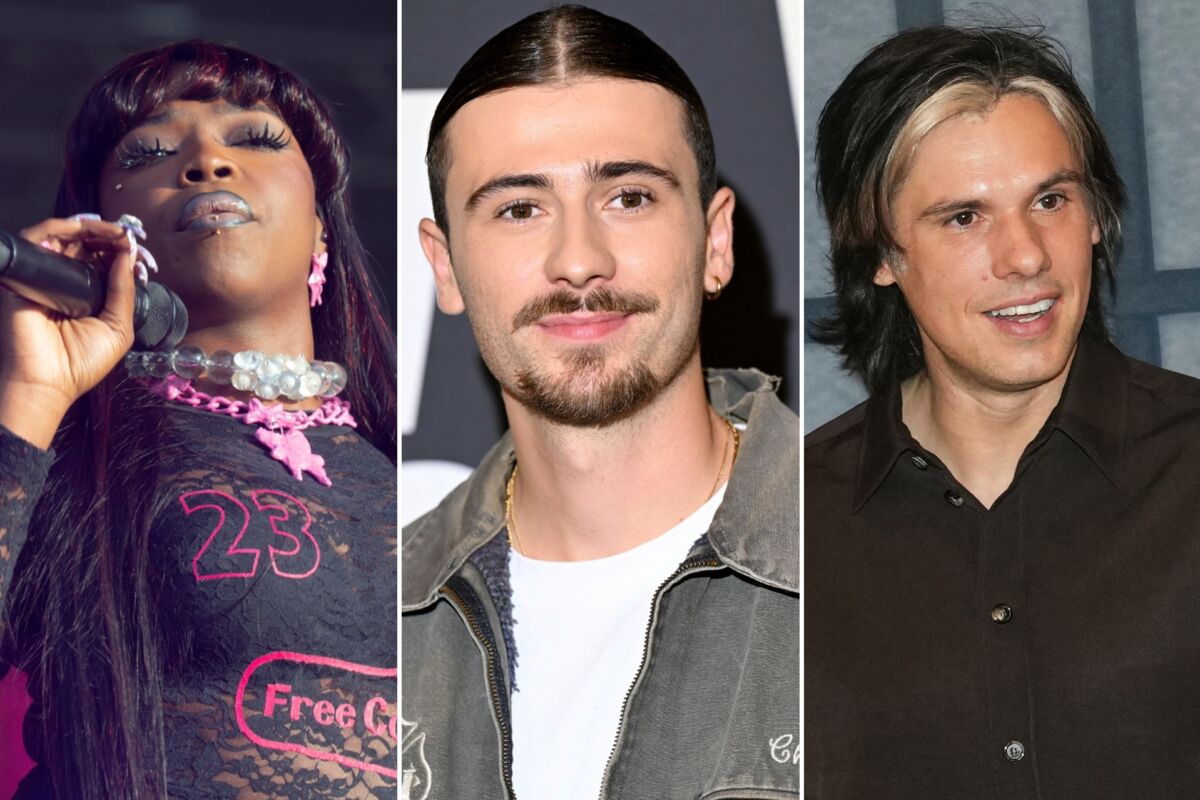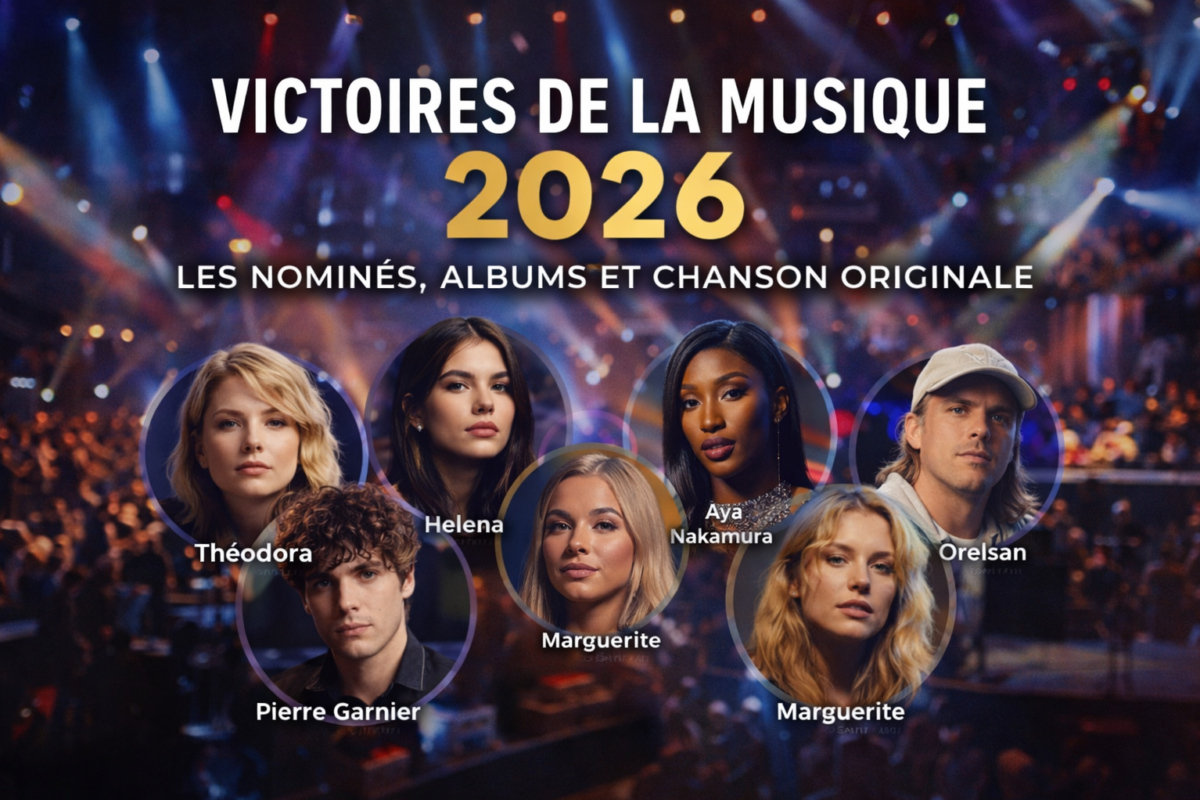Après plus de six semaines d’un blocage paralysant, le Congrès américain a finalement adopté un accord de financement temporaire pour mettre fin au plus long shutdown de l’histoire des États-Unis. Le texte, voté mercredi soir par 222 voix contre 209, permet à des millions d’Américains de retrouver leurs aides sociales et à plus de 800 000 employés fédéraux de toucher enfin leurs salaires suspendus depuis le 1er octobre.
La Maison-Blanche a confirmé que Donald Trump promulguerait le texte dans la soirée, refermant ainsi une crise institutionnelle sans précédent. Mais si l’Amérique respire, les chiffres la rattrapent : la dette publique, déjà abyssale à 38 000 milliards de dollars, s’alourdirait de 1 800 milliards par an selon les projections budgétaires.
« Ce compromis ressemble à une respiration artificielle coûteuse, pas à un plan de redressement », analyse le politologue Mark Daniels cité par Reuters.
💰 Un compromis de survie… financé à crédit
Le texte approuvé au Congrès garantit le financement des agences fédérales jusqu’au 30 janvier 2026, évitant de justesse un nouvel arrêt de l’administration. Derrière ce soulagement politique se cache une logique économique fragile : l’État fédéral s’achète du temps, mais à un prix fiscal record.
Des effets immédiats sur l’économie réelle
Durant les 43 jours de paralysie, les conséquences ont été lourdes : aides alimentaires suspendues, retards dans les remboursements sociaux, trafic aérien perturbé par manque de contrôleurs, services publics à l’arrêt… Cette inertie aurait coûté plus de 10 milliards de dollars en perte de productivité selon plusieurs estimations parlementaires.
Un endettement aggravé, mais un risque social contenu
Le budget voté empêche pour l’instant les licenciements massifs envisagés dans la fonction publique fédérale, une « victoire symbolique » pour les syndicats selon Sarah Kline, économiste chez GlobalData Economics. Cependant, prévient-elle, « cet accord reporte simplement la question de la soutenabilité des dépenses publiques — la bombe budgétaire continue de tic-tacquer ».
La “trêve” offre donc une stabilité temporaire à l’économie américaine, mais creuse davantage le déficit et reporte les réformes structurelles promises par Donald Trump.
⚖️ Un bras de fer politique sans gagnant
Ni les républicains ni les démocrates ne sortent renforcés de ce conflit. Le shutdown a mis en lumière la fragmentation du Congrès et l’absence de consensus sur les grands dossiers sociaux, notamment les remboursements de soins de santé.
Des démocrates divisés malgré leurs succès électoraux
Malgré une série de victoires locales une semaine plus tôt, huit sénateurs démocrates ont choisi de braver la ligne du parti pour soutenir le compromis républicain. En échange : une simple promesse de vote ultérieur sur la santé, sans garantie de résultat. Un geste qui a irrité la base démocrate et fragilisé la cohésion du parti.
Les républicains sauvent la face, mais pas leur image
Le speaker républicain Mike Johnson n’a offert aucune concession substantielle aux démocrates, préférant miser sur l’unité de son camp. Résultat : un texte adopté, mais une image ternie. D’après un sondage Reuters/Ipsos, 50 % des Américains estiment que les républicains sont responsables du blocage, contre 47 % qui pointent les démocrates — un quasi-équilibre révélateur d’un profond désenchantement politique.
Des marchés inquiets, une crédibilité ébranlée
Les investisseurs n’ont pas manqué de réagir : la volatilité du dollar s’est accrue et le rendement des bons du Trésor à 10 ans a grimpé de 0,3 point, signe d’une confiance financière fragilisée. Pour les marchés, le “sauvetage” du jour ne règle rien de la crise structurelle de gouvernance budgétaire qui mine Washington.
👁 L’œil de l’expert : stabilité politique, instabilité financière
Ce déblocage in extremis illustre la dualité du modèle américain : une capacité d’adaptation politique, mais une fragilité budgétaire chronique. À court terme, la reprise des dépenses publiques soutiendra la consommation et évitera un ralentissement brutal du PIB. À moyen terme, en revanche, la trajectoire de la dette devient insoutenable sans réforme fiscale ou réduction des dépenses.
L’économiste David Rosen résume la situation d’une formule :
Les États-Unis gagnent quelques semaines de stabilité, mais perdent un peu plus de crédibilité financière.
Autrement dit : Washington a évité le mur — mais en empruntant davantage pour repousser l’inévitable.